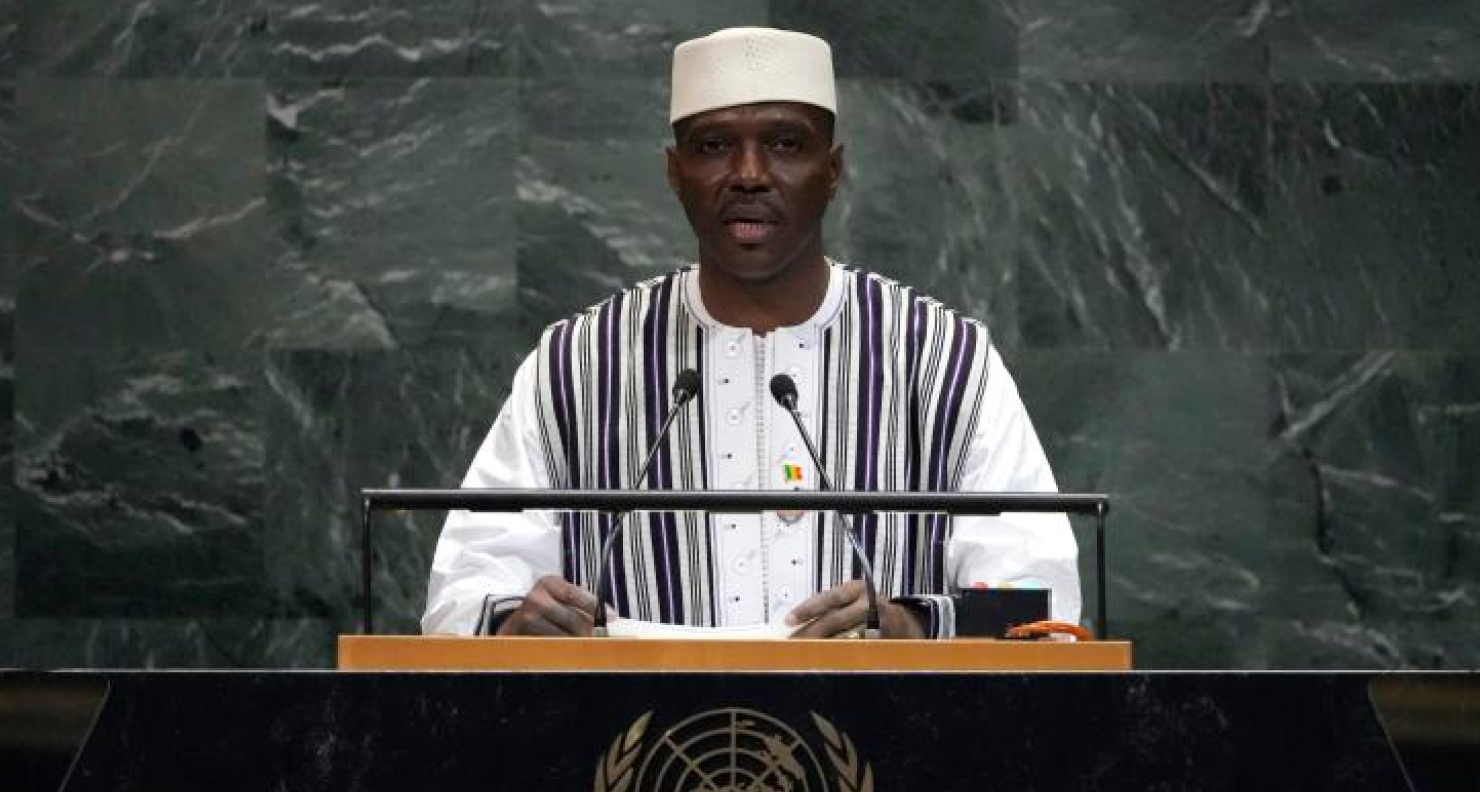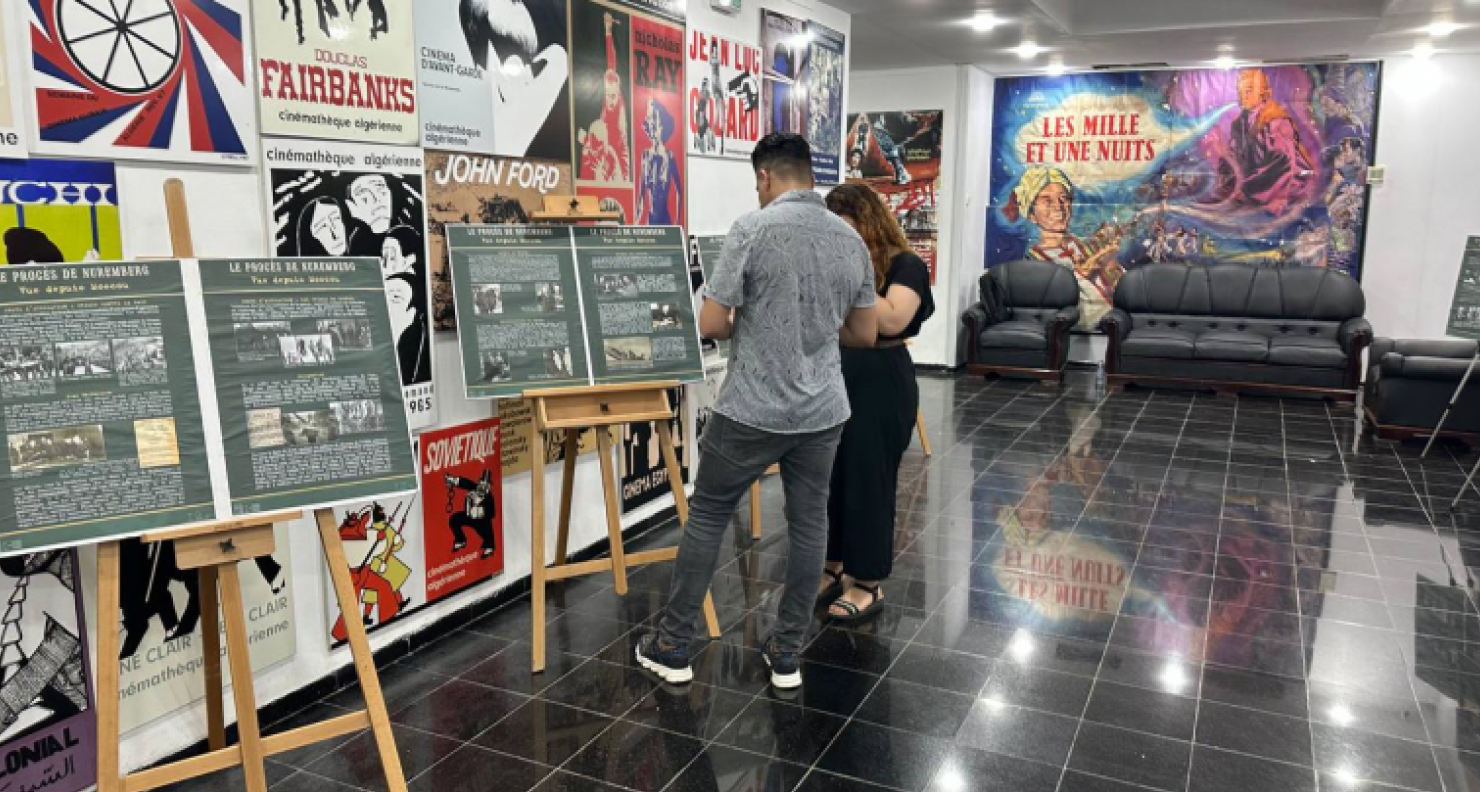La célèbre chanteuse malienne Rokia Traoré, figure emblématique de la musique africaine, se retrouve aujourd’hui enfermée derrière les barreaux en Italie, à la prison pour femmes de Civitavecchia. Ce destin tragique est le résultat d’un contentieux judiciaire qui s’étire depuis plusieurs années, un litige autour de la garde de sa fille, et qui, malgré ses espoirs de pouvoir purger sa peine sous une assignation à résidence à Rome, l’a maintenue en détention. Cette situation soulève de nombreuses questions, non seulement sur les aspects juridiques de cette affaire, mais aussi sur le traitement réservé à cette femme africaine, artiste de renommée internationale, sur le sol européen.
Une carrière exceptionnelle sous le poids des chaînes
Rokia Traoré n’est pas une figure ordinaire de la scène musicale. Issue de la famille noble des Traoré du Mali, elle a su marquer de son empreinte l’univers de la musique world avec son style unique, mêlant traditions maliennes et sonorités modernes. Au fil des années, elle a sorti plusieurs albums acclamés par la critique, tels que Wanita en 2000, Bowmboï en 2003, et Beautiful Africa en 2013. Ses compositions, empreintes de poésie et de messages universels, lui ont valu de nombreuses distinctions, dont le prix RFI Musiques du Monde en 2009 et le prestigieux Prix International des Musiques du Monde de la BBC Radio 3.
Cependant, derrière cette carrière florissante se cache une lutte personnelle qui a pris une tournure dramatique. Depuis 2015, Rokia Traoré est engagée dans une bataille juridique concernant la garde de sa fille, née d’une union avec un ressortissant belge. Ce litige, qui a pris des proportions internationales, a conduit à une situation où la chanteuse se retrouve aujourd’hui prisonnière, non pas de ses choix de vie, mais d’un système juridique complexe et d’une décision de justice qui continue de la maintenir en détention.
Les contours d’une affaire complexe
L’affaire qui a conduit Rokia Traoré derrière les barreaux est liée à une décision de la justice belge qui a confié la garde de sa fille au père de celle-ci, résidant en Belgique. Contestant cette décision, Rokia Traoré avait quitté la Belgique avec sa fille pour s’installer en France, une action considérée par les autorités belges comme un enlèvement. À la suite de cela, un mandat d’arrêt européen a été émis contre elle, conduisant à son arrestation en Italie en 2020.
Depuis son incarcération, Rokia Traoré a fait plusieurs demandes pour être assignée à résidence, espérant pouvoir quitter la prison de Civitavecchia pour rejoindre Rome, où elle pourrait continuer à préparer sa défense dans de meilleures conditions. Toutefois, la Cour suprême de cassation italienne a récemment rejeté cette demande, confirmant ainsi son maintien en détention.
Les motifs de ce refus reposent principalement sur le risque de fuite et sur la gravité des accusations portées contre elle. Pour les autorités italiennes, l’assignation à résidence ne garantirait pas suffisamment que Rokia Traoré respecterait les conditions imposées par la justice, étant donné le précédent où elle avait quitté la Belgique avec sa fille en dépit d’une décision de justice.

Un regard sur la justice européenne et le traitement des Africains
Cette affaire soulève des interrogations quant à l’impartialité de la justice européenne et au traitement réservé aux Africains, même lorsqu’ils jouissent d’une renommée internationale. L’incarcération prolongée de Rokia Traoré dans une prison italienne, loin de sa famille et de son pays d’origine, pourrait être perçue comme un symbole des difficultés auxquelles sont confrontés les Africains dans un système judiciaire occidental souvent perçu comme peu sensible aux réalités culturelles et personnelles des citoyens du Sud.« Comment peut-on maintenir en prison une femme dont le seul crime est de vouloir être auprès de sa fille ? », se demandent de nombreux défenseurs des droits humains et fans de l’artiste. Ce cas met en lumière le déséquilibre qui persiste entre les droits des Africains et la rigidité des lois européennes.
La voix de l’Afrique doit être entendue
Rokia Traoré, malgré ses succès artistiques, se retrouve piégée dans un système qui semble insensible à sa condition de mère et d’Africaine. Cette situation, au-delà des considérations juridiques, doit interpeller sur la manière dont sont traitées les personnalités africaines dans les conflits internationaux.
Il est impératif que la communauté internationale, particulièrement les pays africains, s’unissent pour dénoncer cette situation inacceptable. « Une Afrique forte est une Afrique qui protège ses enfants, où qu’ils soient ». Il est temps que Rokia Traoré retrouve sa liberté et puisse enfin vivre paisiblement auprès de sa fille. La justice ne doit pas se contenter d’appliquer des lois rigides ; elle doit aussi faire preuve d’humanité.