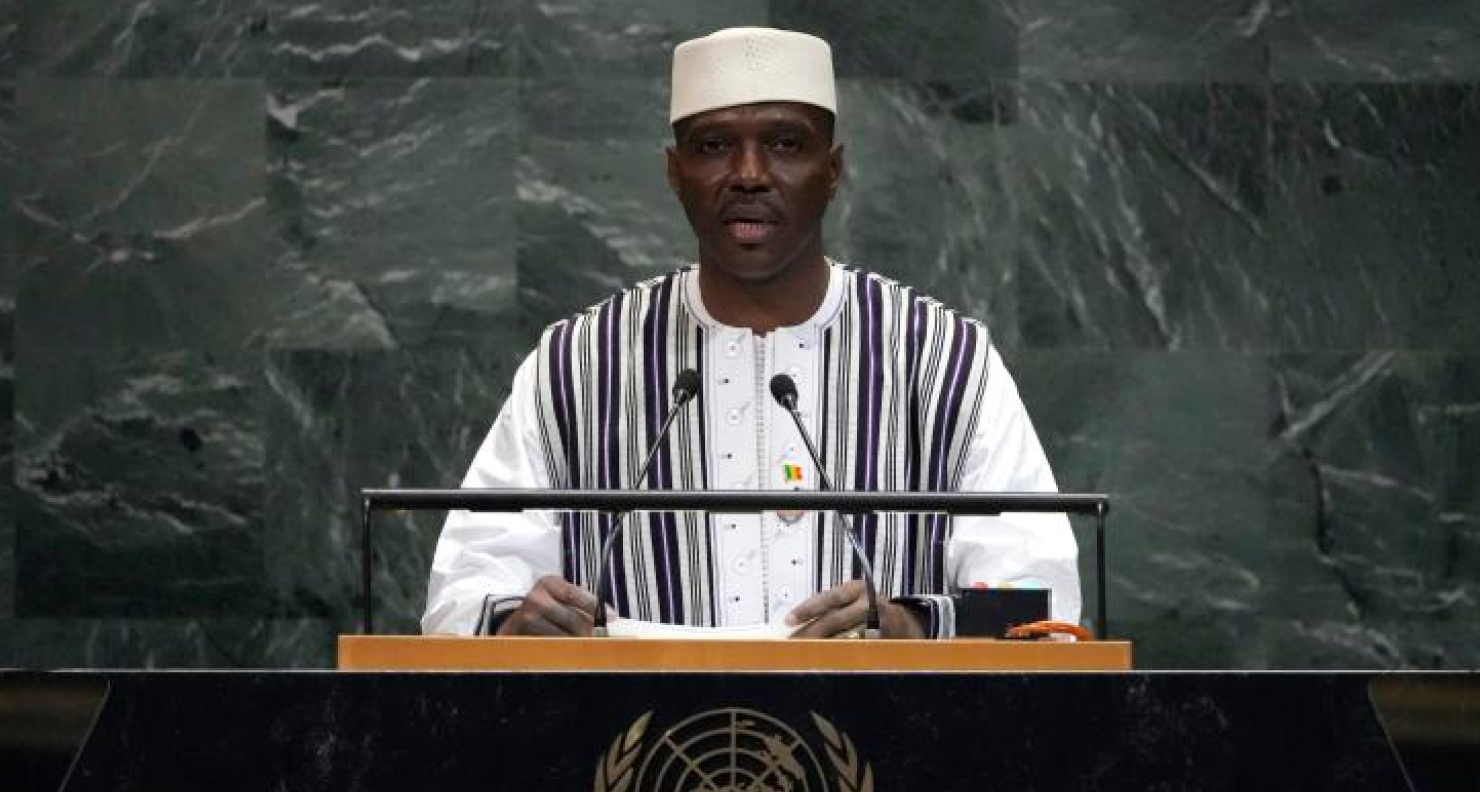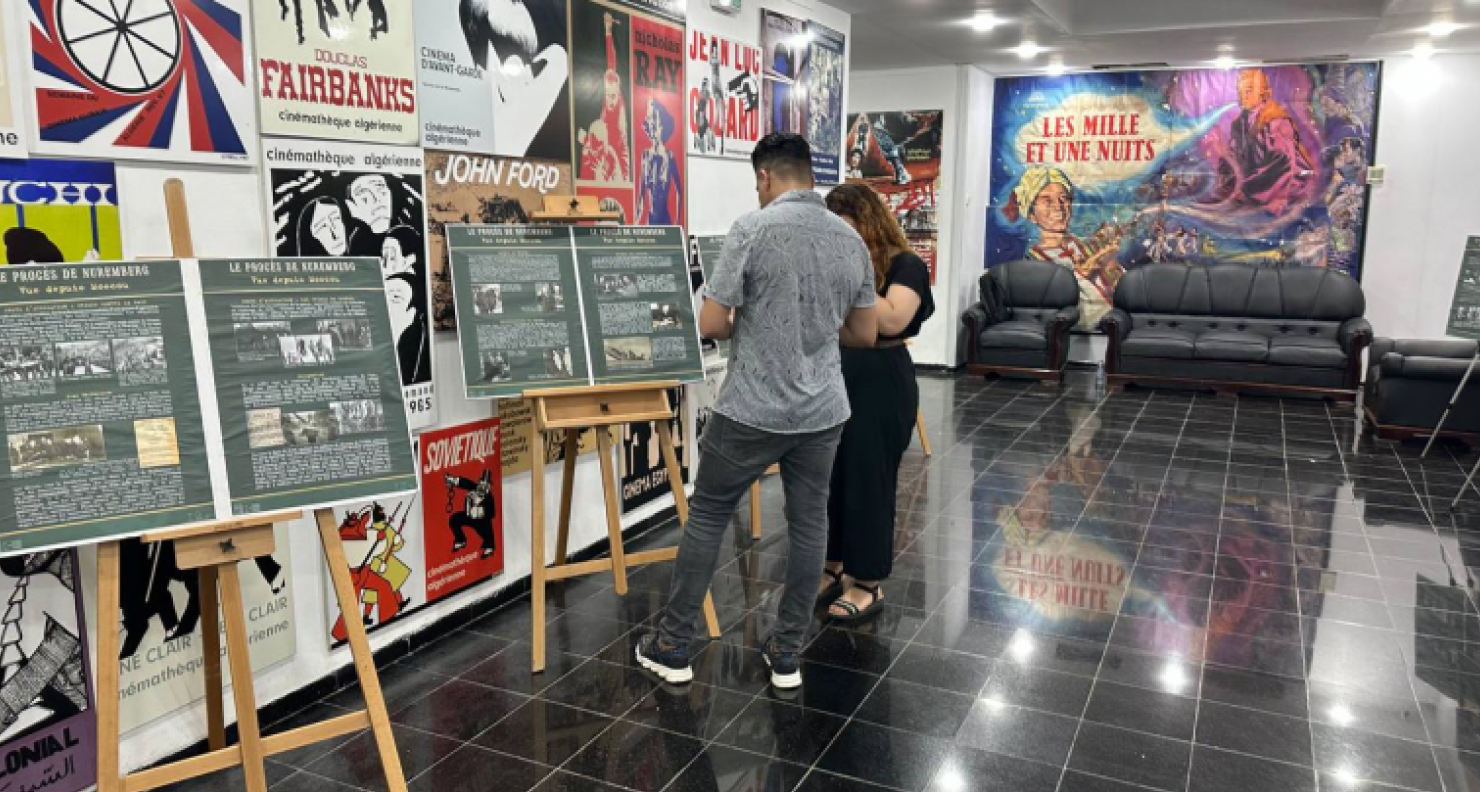Le 5 août 2025, le Zimbabwe a annoncé l’interdiction du commerce de rue, des ventes nocturnes et du commerce de vêtements de seconde main. Le ministre des Collectivités locales et des Travaux publics a présenté cette mesure comme une étape vers la formalisation de l’économie. Mais dans un pays où le secteur informel constitue une source essentielle de revenus pour des millions de personnes, cette décision soulève de vives interrogations sur ses répercussions sociales et économiques.
Selon le ministre Daniel Garwe, cette interdiction vise à soutenir les commerçants enregistrés, qui respectent les règles fiscales mais font face à une concurrence informelle jugée déloyale. Le gouvernement souhaite aussi lutter contre les trafics illicites souvent liés aux marchés de rue, notamment le trafic de drogue et d’autres substances interdites. Cette politique s’inscrit dans une volonté de renforcer l’ordre public et de structurer l’économie urbaine.
À Harare, où le commerce informel est omniprésent, l’annonce suscite tensions et incertitudes. Les autorités locales, appuyées par la police, ont reçu instruction de faire appliquer la nouvelle réglementation sans brutalité, avec une approche pédagogique. Cependant, la mesure pourrait fragiliser des milliers de vendeurs, notamment de friperies, un secteur clé de l’économie circulaire africaine. Pour ces commerçants, souvent sans emploi formel, la vente de vêtements de seconde main représente un filet de sécurité essentiel.
En interdisant une large part du commerce informel, le Zimbabwe prend un virage risqué. La volonté de régulariser l’économie et de lutter contre les trafics se heurte à la réalité sociale d’un pays où le secteur informel absorbe une grande partie de l’emploi. Cette réforme soulève ainsi une question centrale pour de nombreux pays africains : comment concilier rigueur économique et inclusion sociale sans compromettre la survie de millions de citoyens ? Le Zimbabwe devient un cas d’école à observer.