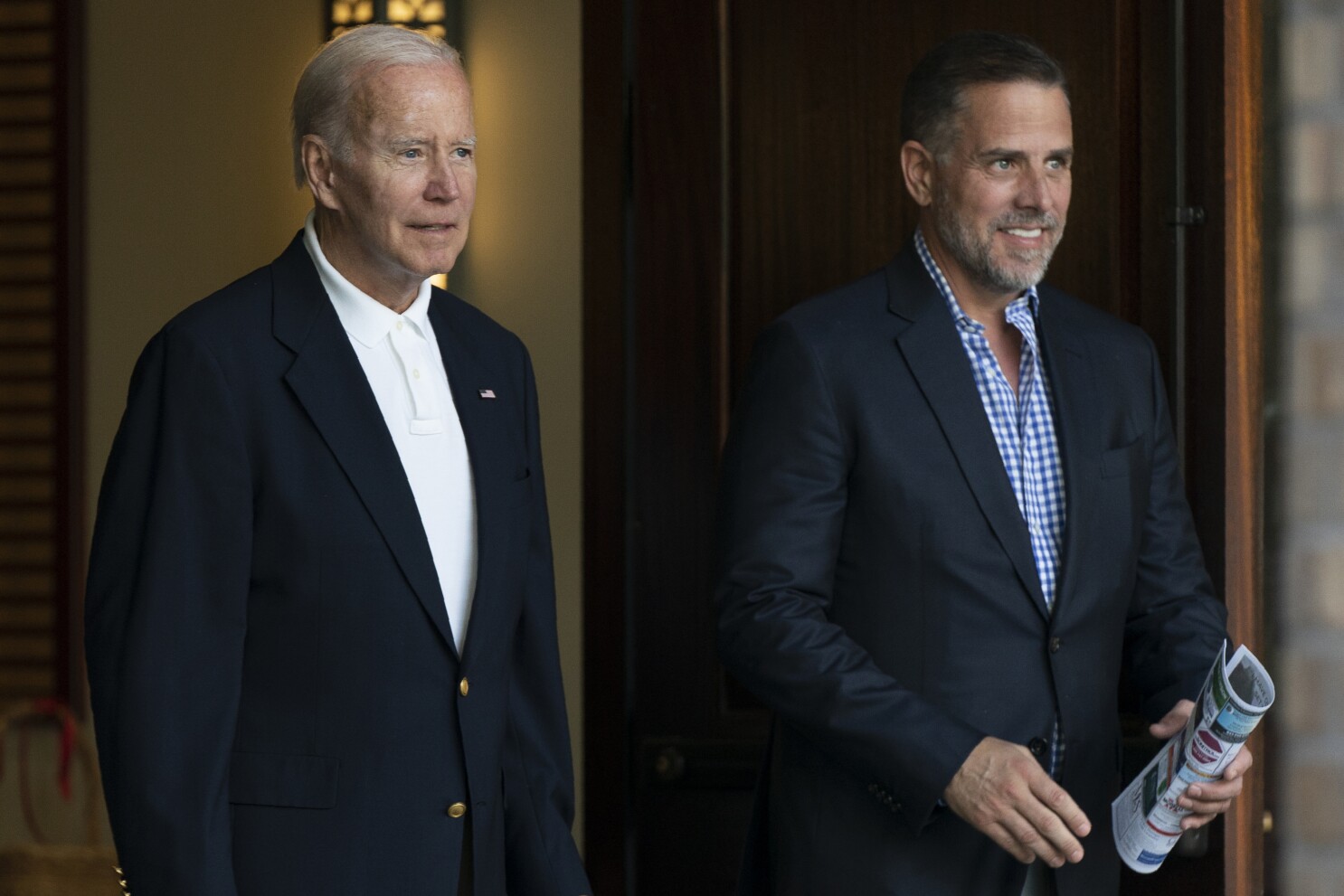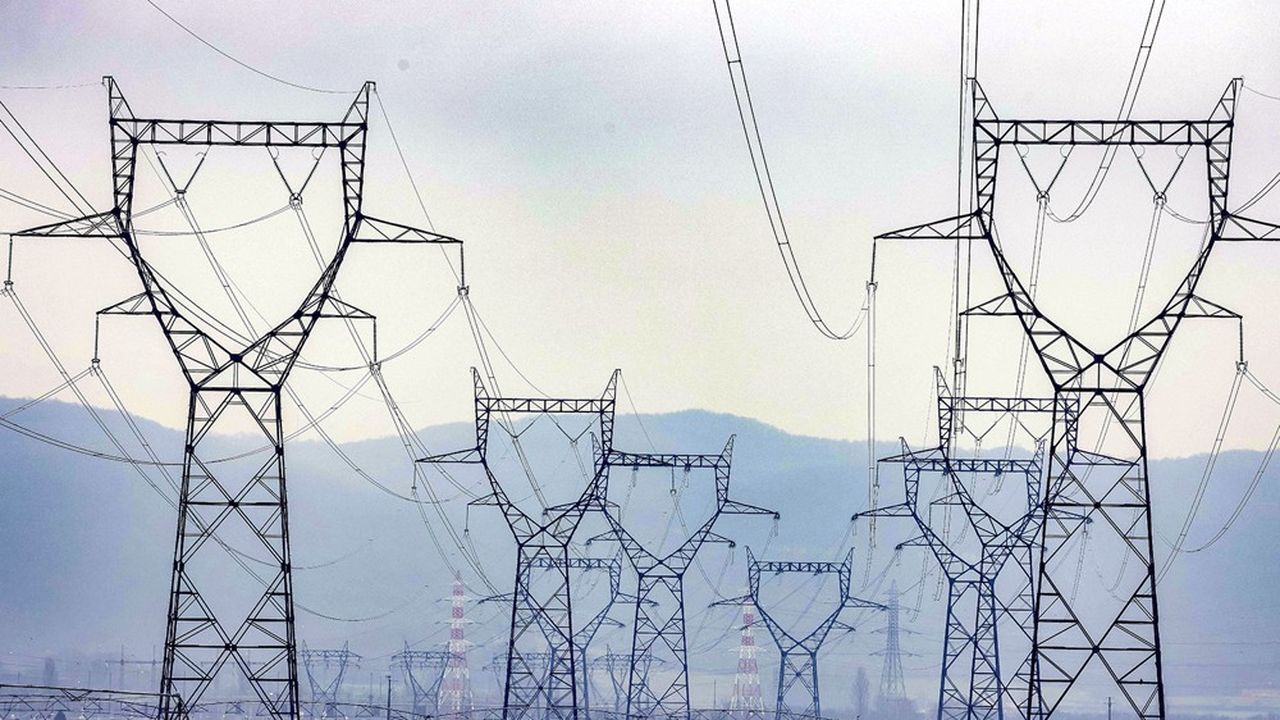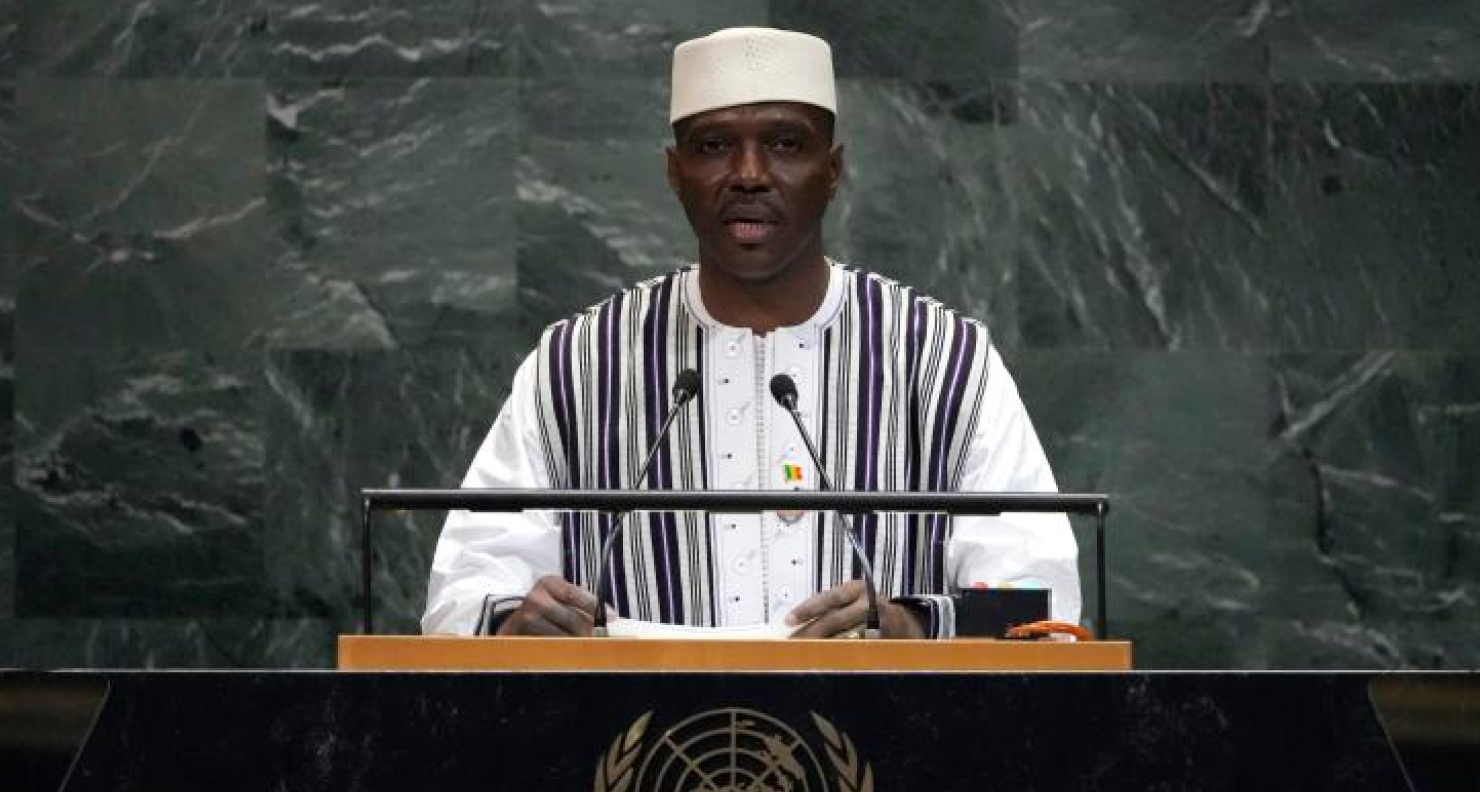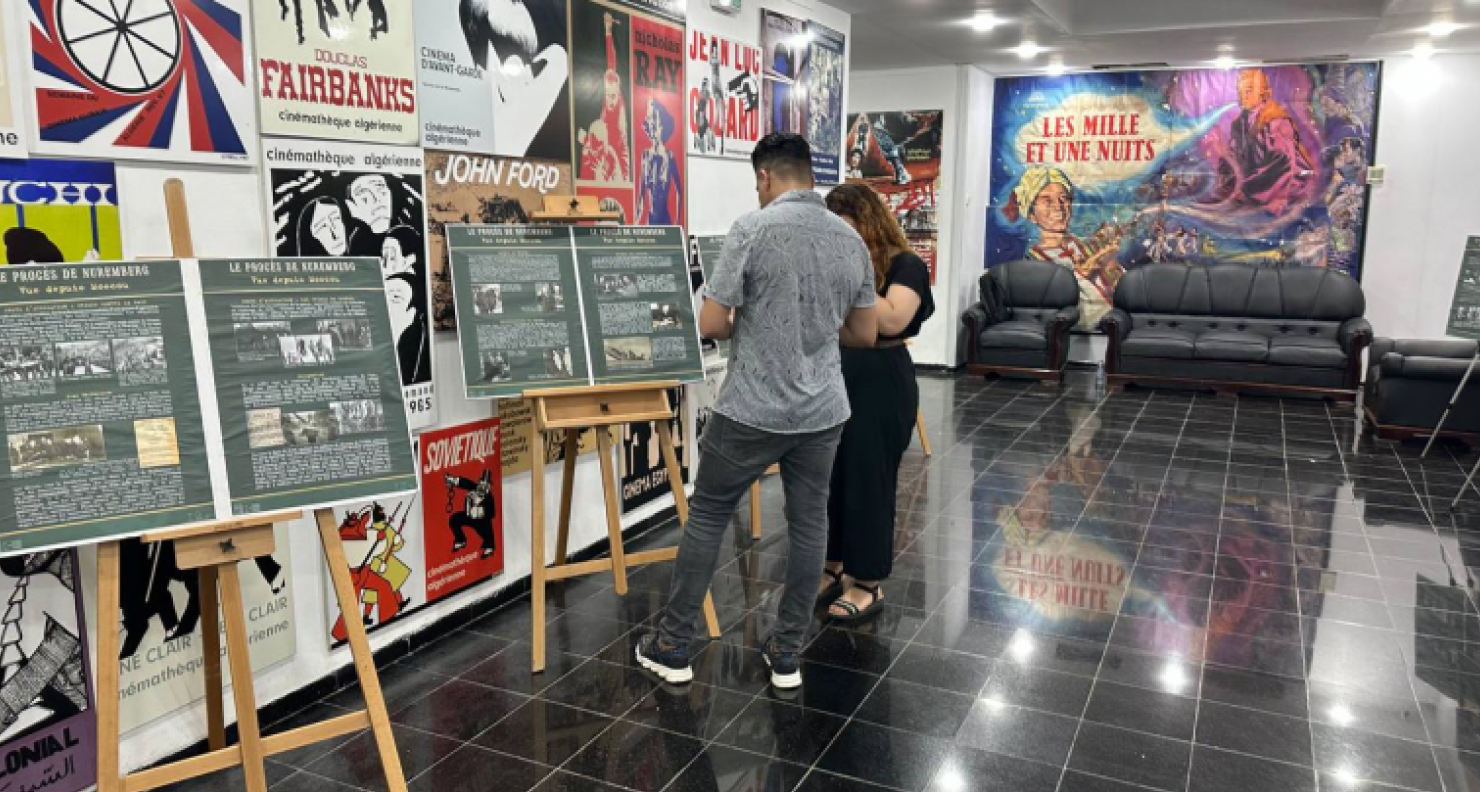Le 31 juillet 2025, le Parlement salvadorien, dominé par le parti « Nouvelles Idées » du président Nayib Bukele, a approuvé à une large majorité une réforme qui supprime la limite des mandats présidentiels et abolit le second tour de l’élection. Bukele, réélu en 2024 malgré l’interdiction initiale de la Constitution, pourra ainsi se représenter sans restriction à partir de 2027. Si cette décision inquiète de nombreuses organisations locales et internationales, elle bénéficie pourtant d’un fort soutien populaire.
Selon un sondage de l’Institut Universitaire d’Opinion Publique (UCA), près de 75 % des Salvadoriens estiment que la continuité de Bukele est préférable à une alternance politique, en raison de ses résultats dans la lutte contre l’insécurité. Cette adhésion rappelle des dynamiques observées en Afrique, où certains chefs d’État restent au pouvoir pendant plusieurs décennies. Paul Biya, au Cameroun, est au pouvoir depuis 1982, Teodoro Obiang Nguema en Guinée équatoriale depuis 1979. En Ouganda, Yoweri Museveni a modifié la Constitution pour prolonger son règne commencé en 1986. Tous justifient leur longévité par des raisons de stabilité, comme le fait aujourd’hui Bukele.
Mais au Salvador, certains redoutent de voir le pays suivre cette trajectoire. L’opposante Marcela Villatoro dénonce une dérive autoritaire : « La démocratie au Salvador est morte », a-t-elle déclaré. Des ONG comme Cristosal ou la Commission salvadorienne des droits humains alertent sur une centralisation excessive du pouvoir, accentuée par la révocation de juges et l’usage prolongé de l’état d’urgence. À la différence de certains contextes africains marqués par une contestation populaire croissante, le cas salvadorien illustre un paradoxe : une popularité record (Bukele a été réélu avec 85 % des voix) combinée à des inquiétudes sur l’avenir démocratique. Ce glissement interroge les équilibres fragiles entre efficacité politique, droits fondamentaux et séparation des pouvoirs des enjeux partagés bien au-delà de l’Amérique latine.