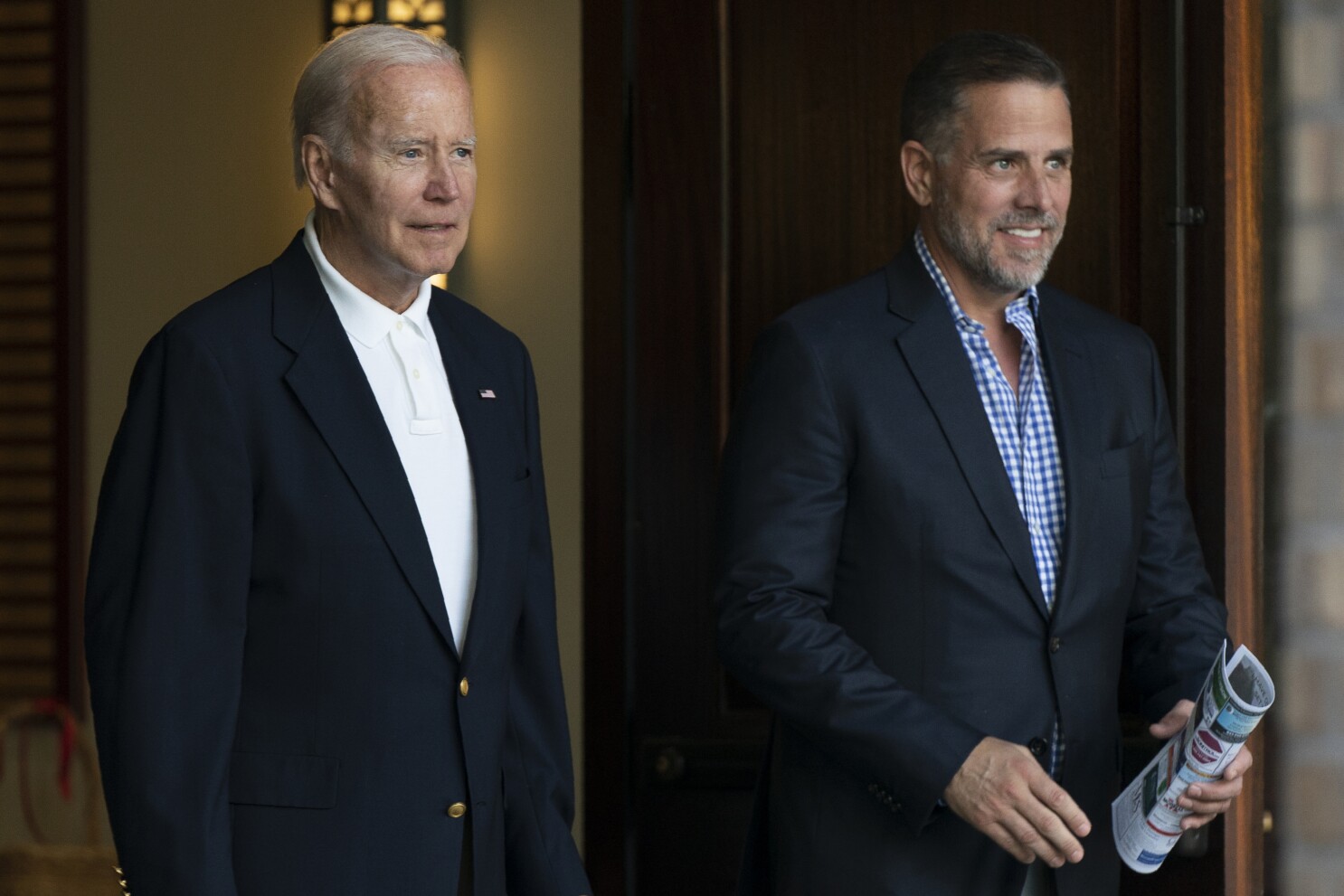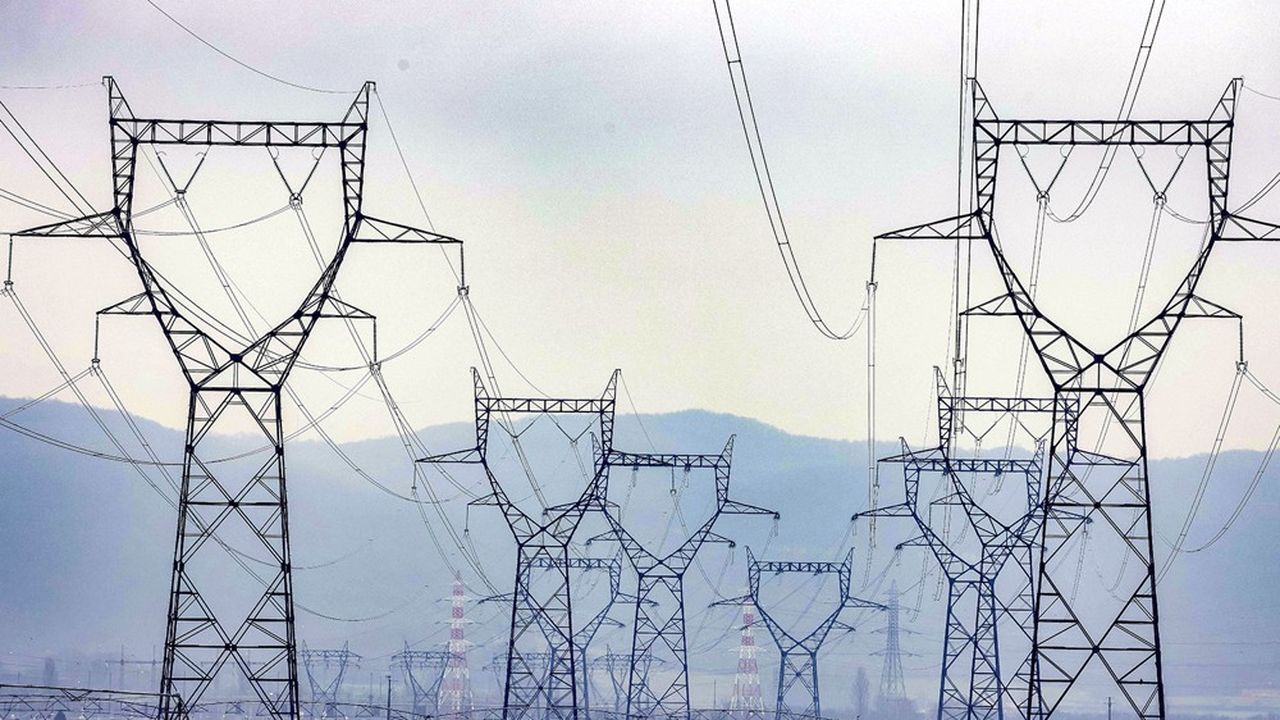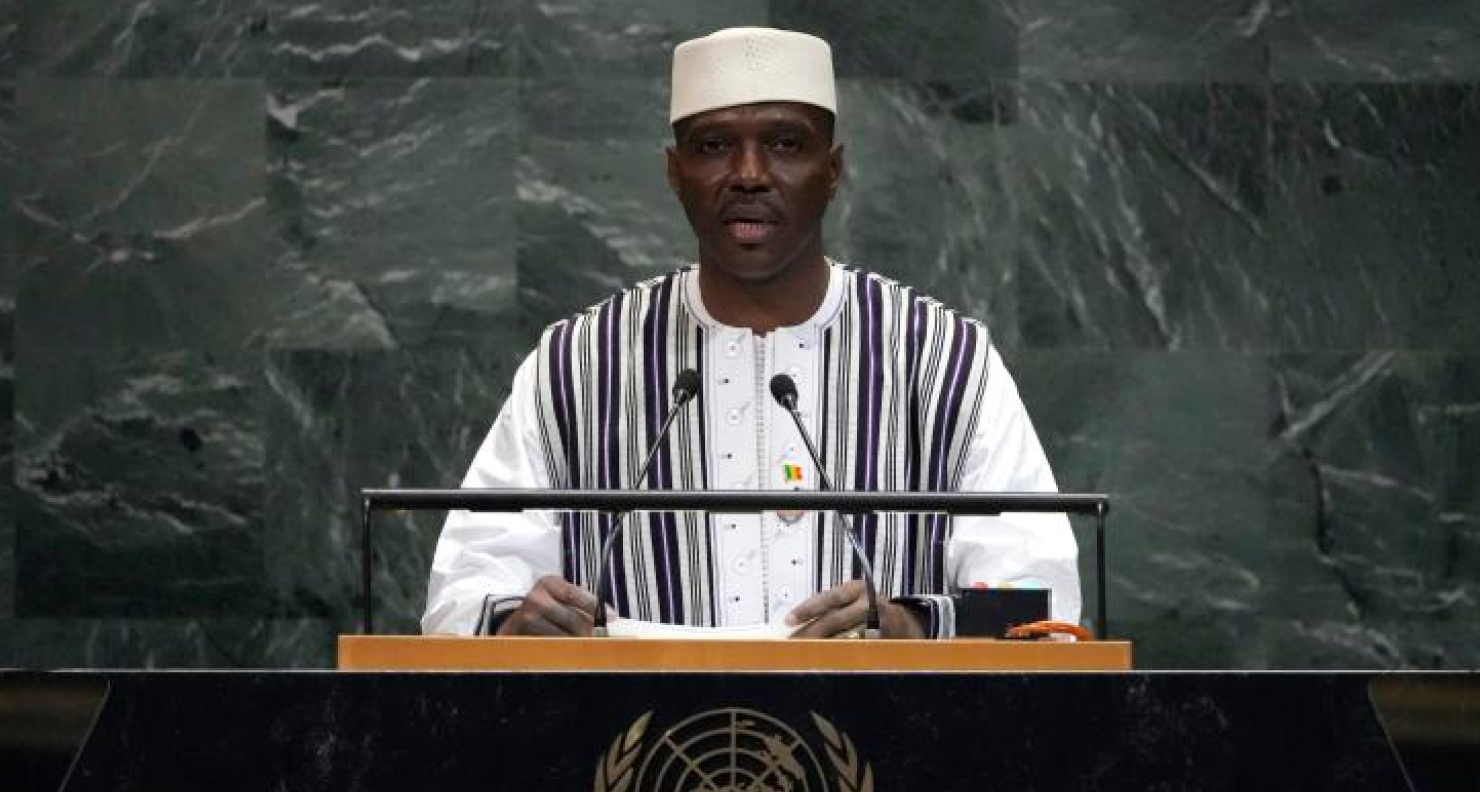Une présidentielle sous le signe du doute
Le scrutin est fixé au 12 octobre 2025, mais à l’approche de l’échéance, la crédibilité du processus est déjà contestée. Elections Cameroon (Elecam), chargé de l’organisation, assure que le « toilettage » des listes est en cours et promet leur publication définitive seulement huit jours avant le vote. Cette gestion tardive ravive les soupçons d’irrégularités et réactive un vieux débat : peut-on garantir un scrutin fiable sans transparence sur le fichier électoral ?
Des anomalies persistantes
Le mouvement Stand Up For Cameroon a dénoncé plusieurs incohérences, parmi lesquelles l’inscription de personnes décédées, des fiches incomplètes ou encore des photos de mineurs. « L’ampleur réelle du problème reste inconnue tant que le fichier global n’est pas accessible », estime l’ingénieur en informatique Remi Tassing, qui suit le processus. En 2023 déjà, Maurice Kamto avait saisi le Conseil constitutionnel pour exiger la publication des listes, sans succès. Ces réclamations récurrentes traduisent une défiance durable dans un pays marqué par des décennies d’élections contestées.
Elecam rassure, le RDPC relativise
Pour calmer les inquiétudes, Elecam promet la mise en ligne prochaine de listes provisoires et leur affichage local afin de permettre aux électeurs de déposer des réclamations. Les listes définitives seraient disponibles au plus tard le 5 octobre. Même le Rassemblement démocratique du peuple camerounais (RDPC), au pouvoir, reconnaît la sensibilité du sujet. « La fiabilité du fichier électoral est une question lancinante », admet son militant Patrick Rifoe, tout en assurant que son parti fait confiance à Elecam pour corriger les irrégularités.
La société civile en première ligne
Face à ces incertitudes, des acteurs politiques et citoyens appellent à une vigilance renforcée le jour du scrutin. Selon eux, seule une mobilisation massive et active des électeurs peut limiter les fraudes et préserver la crédibilité du processus. Dans ce climat de suspicion, la participation populaire apparaît comme le dernier rempart démocratique. Le débat sur la fiabilité du fichier électoral illustre les défis de transparence et de gouvernance qui traversent non seulement le Cameroun, mais de nombreuses démocraties africaines. Si Elecam promet des avancées, c’est avant tout la mobilisation citoyenne, au pays comme dans la diaspora, qui pourrait garantir que la présidentielle de 2025 reflète réellement la volonté du peuple camerounais.