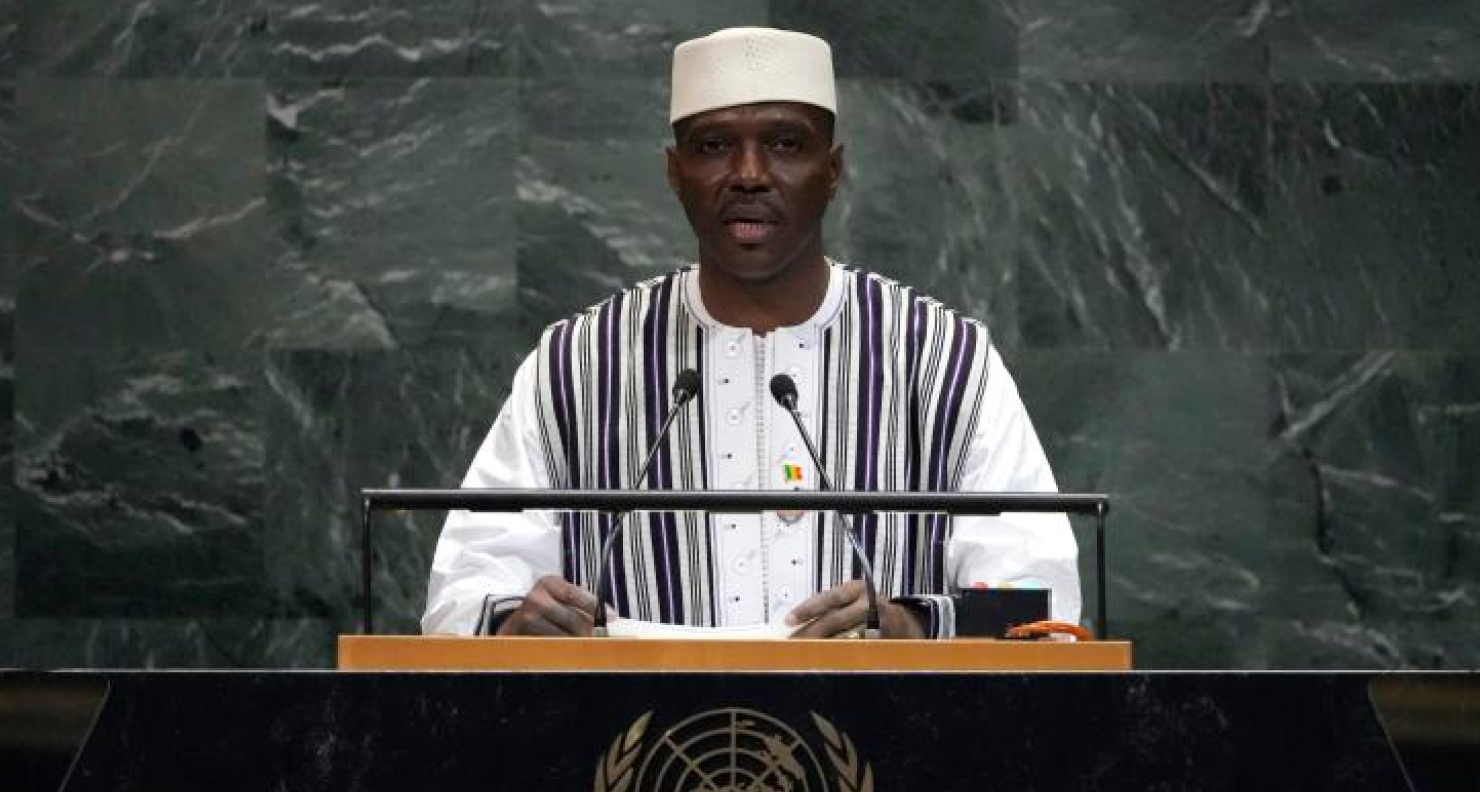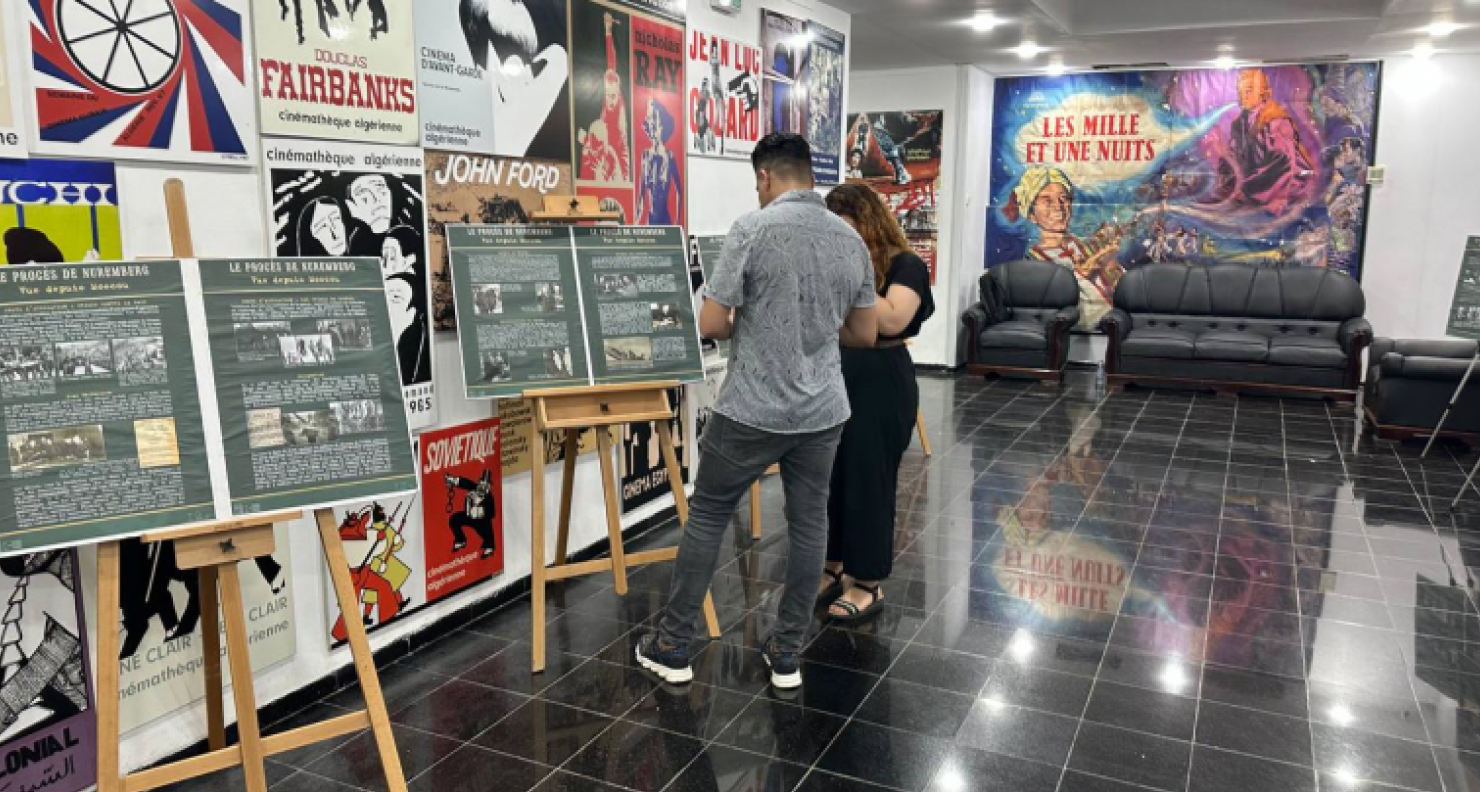La police camerounaise a révélé que ces détenus, déjà condamnés pour d’autres faits, utilisaient des téléphones portables, des cartes SIM et du matériel sophistiqué pour contacter des victimes. Selon les enquêteurs, ils procédaient par appels aléatoires, menaçant les personnes contactées avant de leur réclamer de l’argent. Certaines victimes ont été sommées de verser des sommes importantes sous peine de représailles, illustrant la gravité et l’organisation de ces opérations.
Les investigations ont été déclenchées par une série de plaintes déposées auprès de l’Agence de régulation des télécommunications. Elles ont permis de mettre en lumière un fonctionnement comparable à un centre d’appels clandestin, structuré et incluant même d’anciens employés de sociétés de téléphonie mobile aujourd’hui écroués. L’affaire soulève des questions sur la gouvernance et la sécurité à l’intérieur des prisons, et sur la possible implication de personnels pénitentiaires dans ces activités.
Pour les détenus concernés, cette nouvelle infraction pourrait allonger leur durée de détention. Mais l’enjeu dépasse les sanctions individuelles : il illustre l’urgence d’une réforme structurelle des prisons pour empêcher que de telles opérations continuent. Les experts soulignent que tant que les établissements pénitentiaires restent vulnérables à la cybercriminalité, la lutte officielle contre les arnaques téléphoniques restera limitée.
Cette affaire constitue une alerte pour le Cameroun et pour d’autres pays africains confrontés à des défis similaires en matière de justice et de sécurité. Elle rappelle aux citoyens l’importance de rester vigilants face aux arnaques téléphoniques et souligne la nécessité d’une gouvernance transparente et rigoureuse dans les établissements pénitentiaires afin de restaurer la confiance publique et de garantir que les prisons ne deviennent pas des foyers de cybercriminalité.