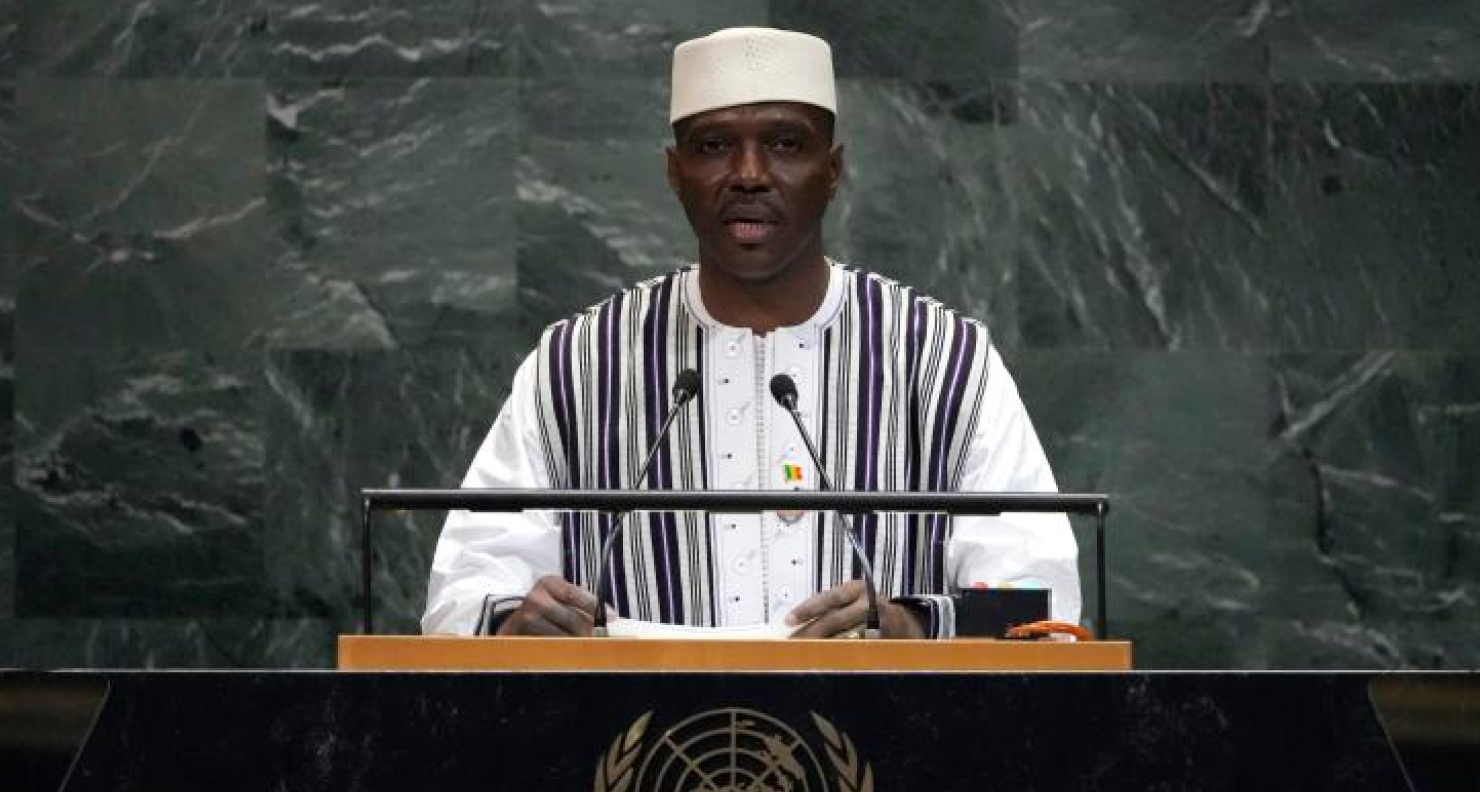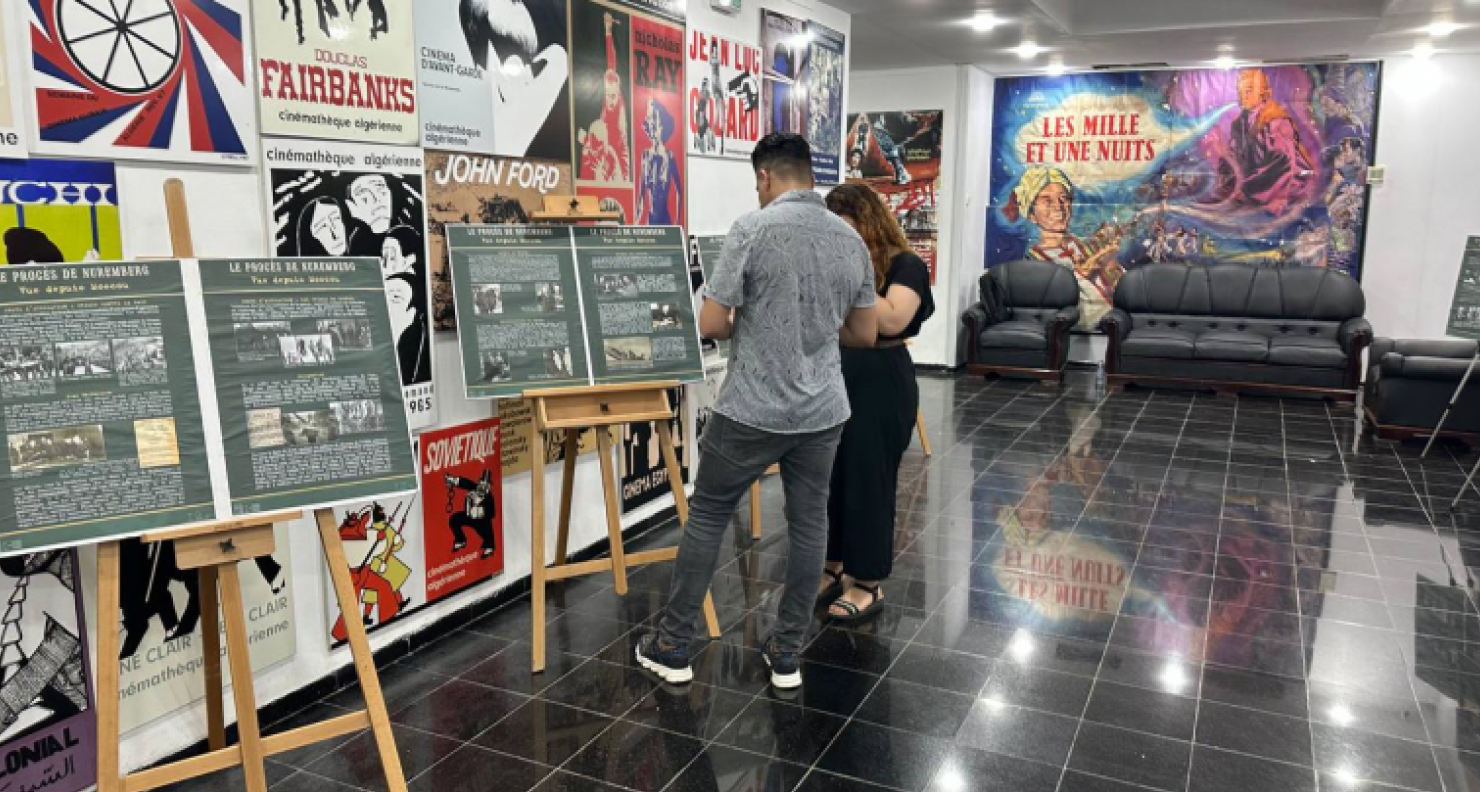Annoncé le 22 juillet 2025 par la porte-parole du Département d’État, Tammy Bruce, ce retrait intervient moins de deux ans après la réintégration des États-Unis sous l’administration Joe Biden. Washington justifie ce départ par des désaccords idéologiques, accusant l’UNESCO de promouvoir un agenda globaliste contraire à ses intérêts nationaux, notamment en matière de politique culturelle et sur la question israélo-palestinienne. Le « parti pris contre Israël » est à nouveau mis en avant, comme lors des précédents désengagements sous les présidences de Ronald Reagan en 1984 et Donald Trump en 2017.
La décision illustre une nouvelle fois la manière dont les orientations politiques internes influencent la place des États-Unis dans les instances internationales. La Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a exprimé son regret tout en soulignant que l’organisation s’y était préparée. Grâce à des réformes financières menées depuis 2018, la structure budgétaire de l’UNESCO a été diversifiée, réduisant la dépendance vis-à-vis des États-Unis.
Malgré ce retrait, les programmes de l’organisation notamment sur le patrimoine, l’éducation et l’intelligence artificielle se poursuivront sans interruption. Plusieurs voix internationales, comme celle d’Emmanuel Macron, ont réaffirmé leur soutien à l’UNESCO, dénonçant une décision nuisible au multilatéralisme. Ce retrait américain, symptôme d’une diplomatie oscillante, pose la question de la stabilité des grandes puissances au sein des systèmes de gouvernance mondiale.