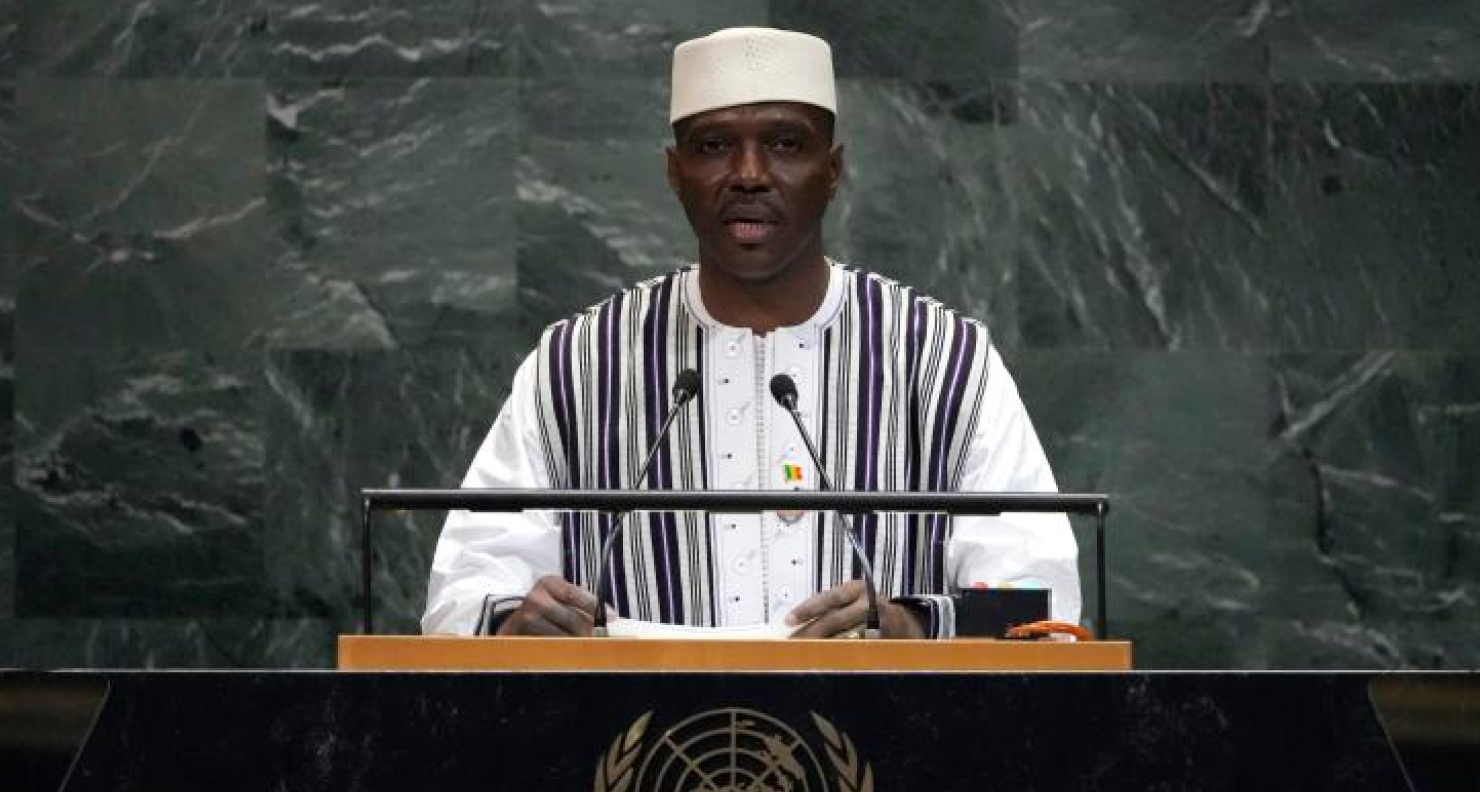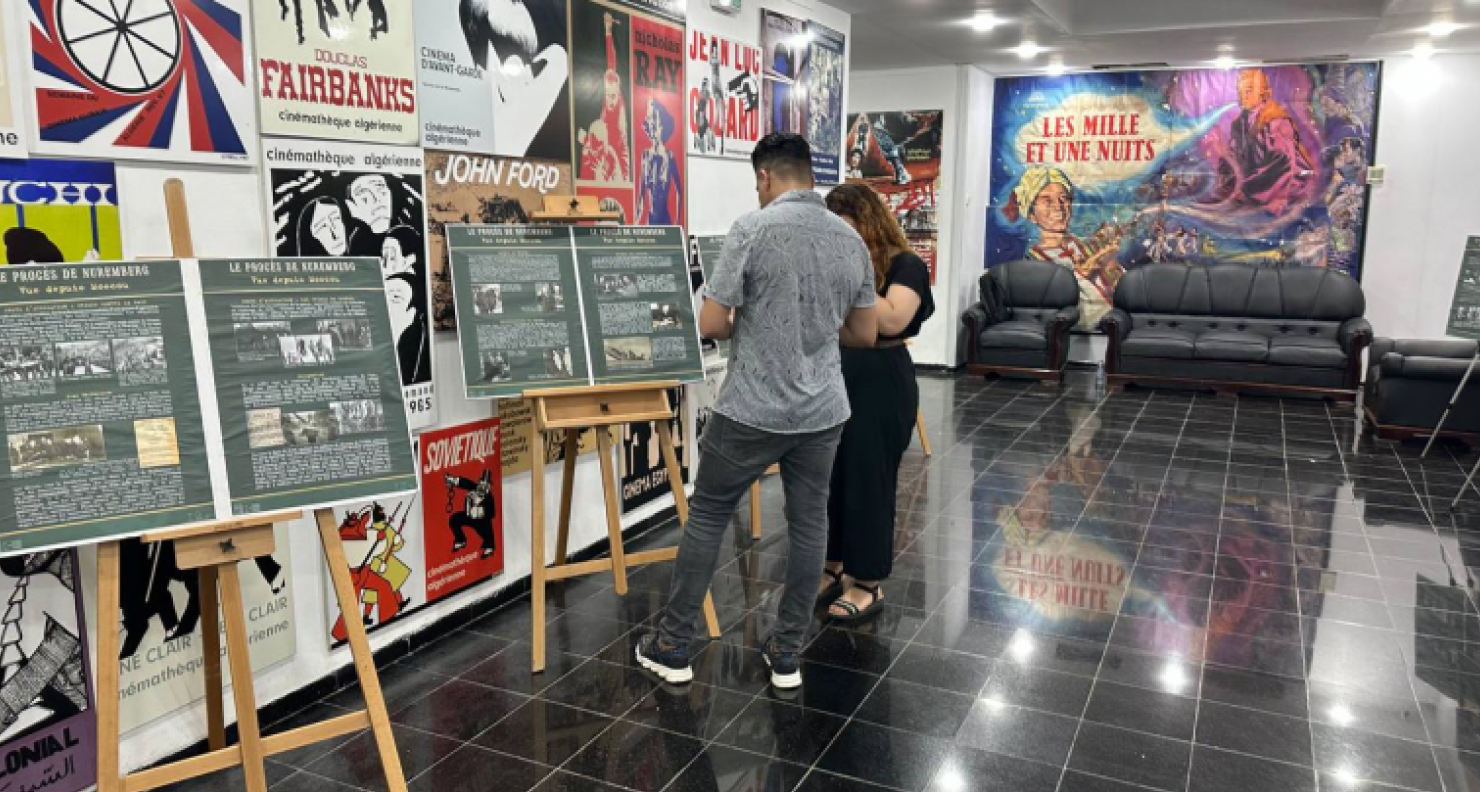L’arrivée de ce premier groupe marque la mise en œuvre concrète d’un dispositif signé avec l’administration de Donald Trump, revenu au pouvoir en janvier. Selon Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement rwandais, les migrants ont bénéficié d’un « soutien approprié et de la protection du gouvernement ». Trois souhaitent retourner dans leur pays d’origine, tandis que quatre ont choisi de s’installer au Rwanda. Leurs nationalités n’ont pas été révélées. Ils sont actuellement hébergés par une organisation internationale, avec le suivi de l’Organisation internationale pour les Migrations (OIM). Kigali a précisé qu’il accepterait jusqu’à 250 personnes expulsées, mais se réserve le droit d’approuver chaque réinstallation.
Le Rwanda met en avant son expérience en matière d’accueil, rappelant avoir hébergé près de 3 000 réfugiés évacués de Libye depuis 2019. Toutefois, l’accord intervient alors que Kigali fait face à des critiques récurrentes sur son bilan en matière de droits humains et son rôle dans le conflit en République démocratique du Congo. Ce partenariat s’inscrit dans une politique plus large des États-Unis visant à expulser massivement des migrants vers des pays tiers, parfois éloignés de leur origine, comme l’Ouganda ou l’Eswatini. Mais des experts en droits humains alertent sur les risques de violations du droit international, soulignant que certains déportés pourraient être exposés à l’insécurité ou à la répression. L’accord États-Unis–Rwanda, à l’instar du précédent pacte conclu avec le Royaume-Uni et annulé en 2024, pose la question de l’avenir de la protection des migrants en Afrique et de la compatibilité de ces pratiques avec les normes internationales.