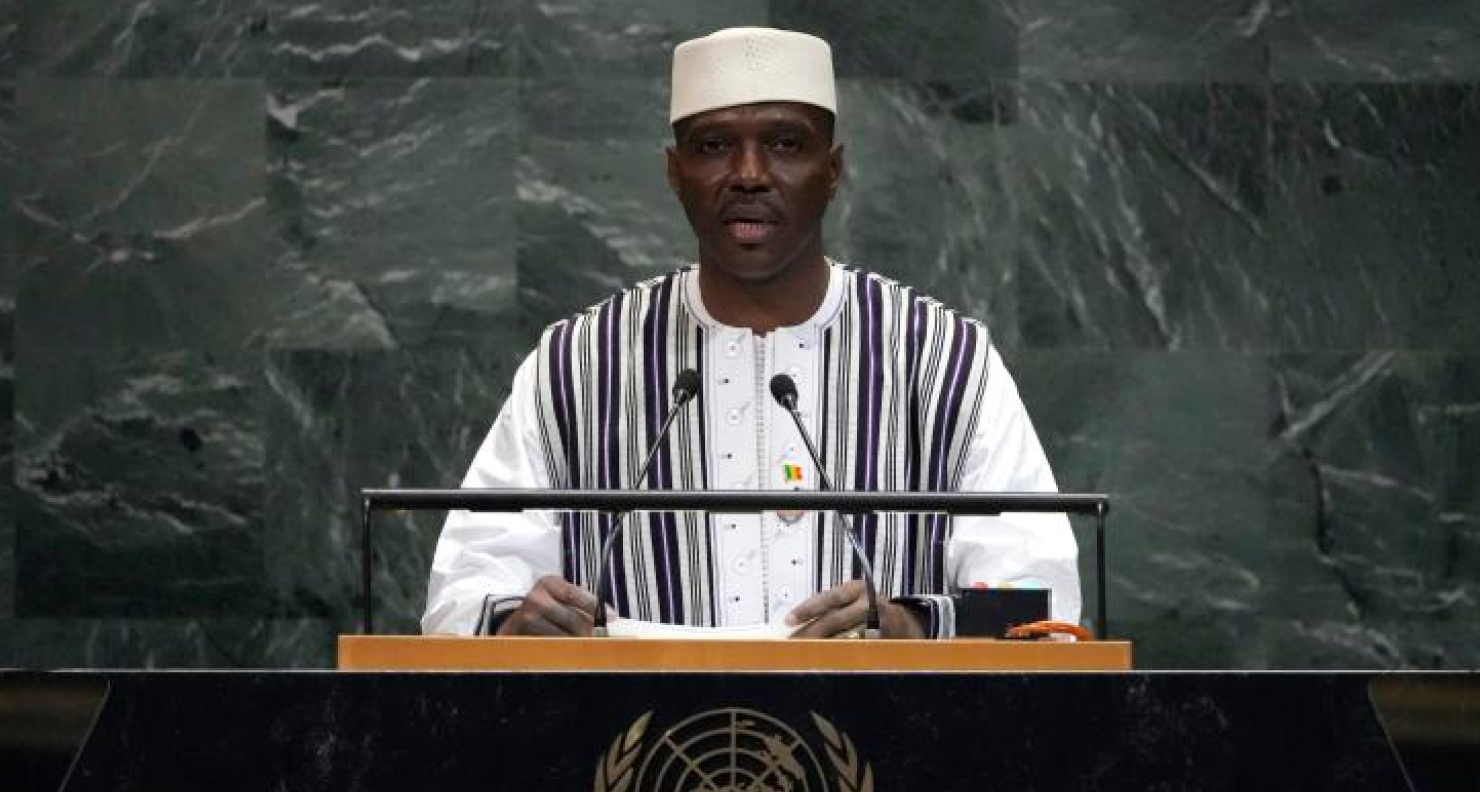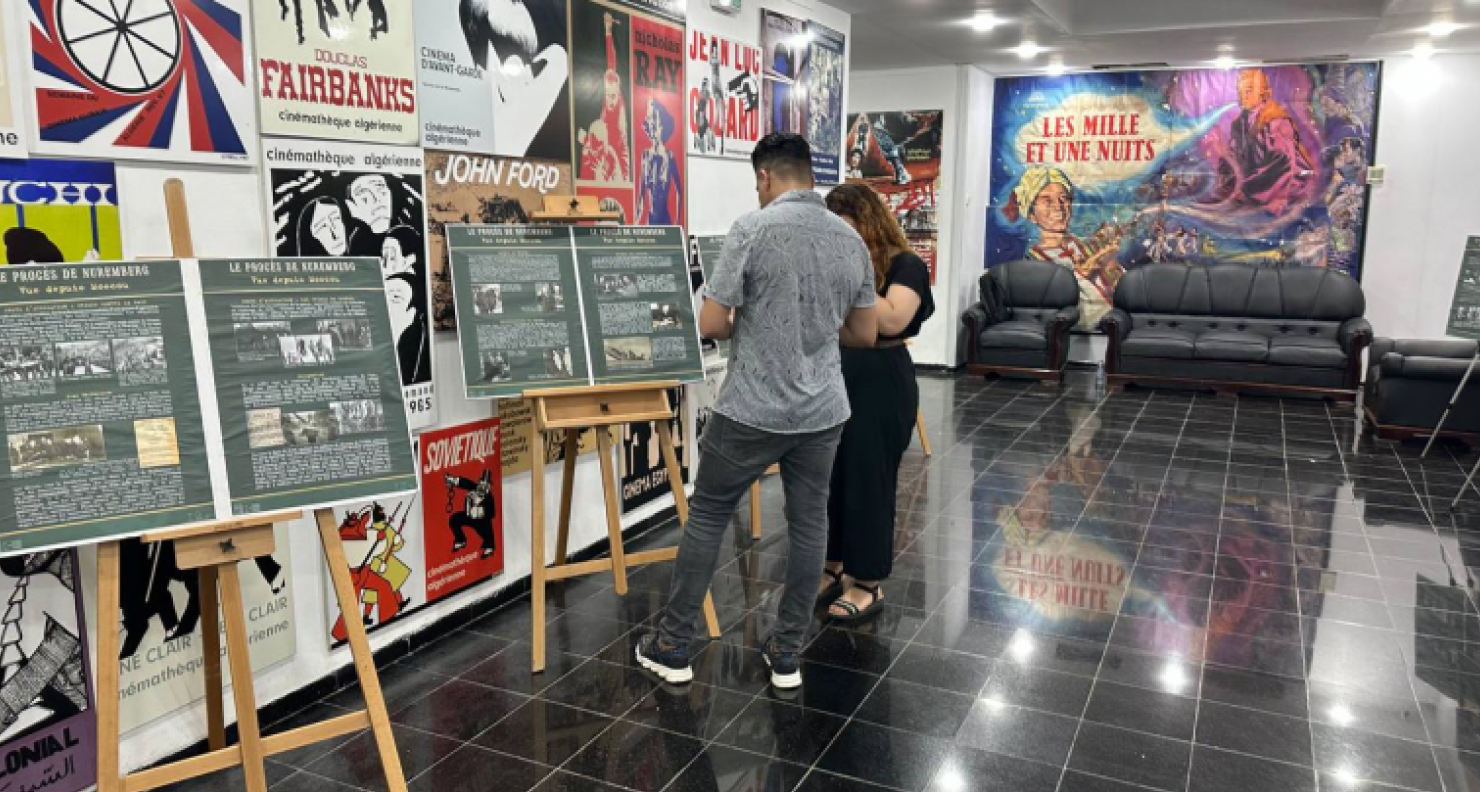La migration entre Haïti et la République Dominicaine, qui partagent l’île d’Hispaniola, est une question ancienne et complexe. Depuis octobre 2024, sous la présidence de Luis Abinader, la politique migratoire dominicaine s’est fortement durcie. L’augmentation des expulsions, la suspension des visas et le renforcement militaire à la frontière, notamment avec la construction d’un mur, visent à réduire les entrées illégales d’Haïtiens. Les chiffres officiels montrent une intensification sans précédent de ces opérations, relançant le débat sur leurs conséquences humanitaires et régionales. La Direction générale des migrations (DGM) rapporte une moyenne mensuelle de plus de 30 000 expulsions. En juillet 2025, 31 462 Haïtiens ont été renvoyés.
L’objectif officiel est d’atteindre 10 000 expulsions par semaine. Sur neuf mois, plus de 300 000 migrants ont ainsi été renvoyés en Haïti. Luis Lee Ballester, directeur de la DGM, a incité les migrants en situation irrégulière à « retourner volontairement dans leur pays ». La stratégie dominicaine se traduit par des rafles régulières, la suspension des visas et un déploiement militaire renforcé à la frontière. La construction d’un mur marque symboliquement cette volonté de contrôle. Les autorités préviennent que les interdictions et contrôles vont s’intensifier, touchant même les maternités, où des femmes sans papiers font l’objet de rafles. Haïti, considéré comme le pays le plus pauvre de la région, fait face à une longue crise de violence et d’anarchie liée aux gangs.
Le retour de dizaines de milliers de personnes dans ce contexte exacerbe les difficultés économiques, sécuritaires et sociales, posant un défi majeur à un État aux capacités d’accueil limitées. La République Dominicaine met en œuvre une politique d’expulsions à une échelle inédite, renvoyant plus de 300 000 Haïtiens en moins d’un an. Cette dynamique reflète les tensions migratoires régionales et les graves enjeux humanitaires qu’elles impliquent. Pour les populations africaines et la diaspora, cette crise souligne l’importance de la stabilité et de la solidarité face aux vulnérabilités des migrations contemporaines.