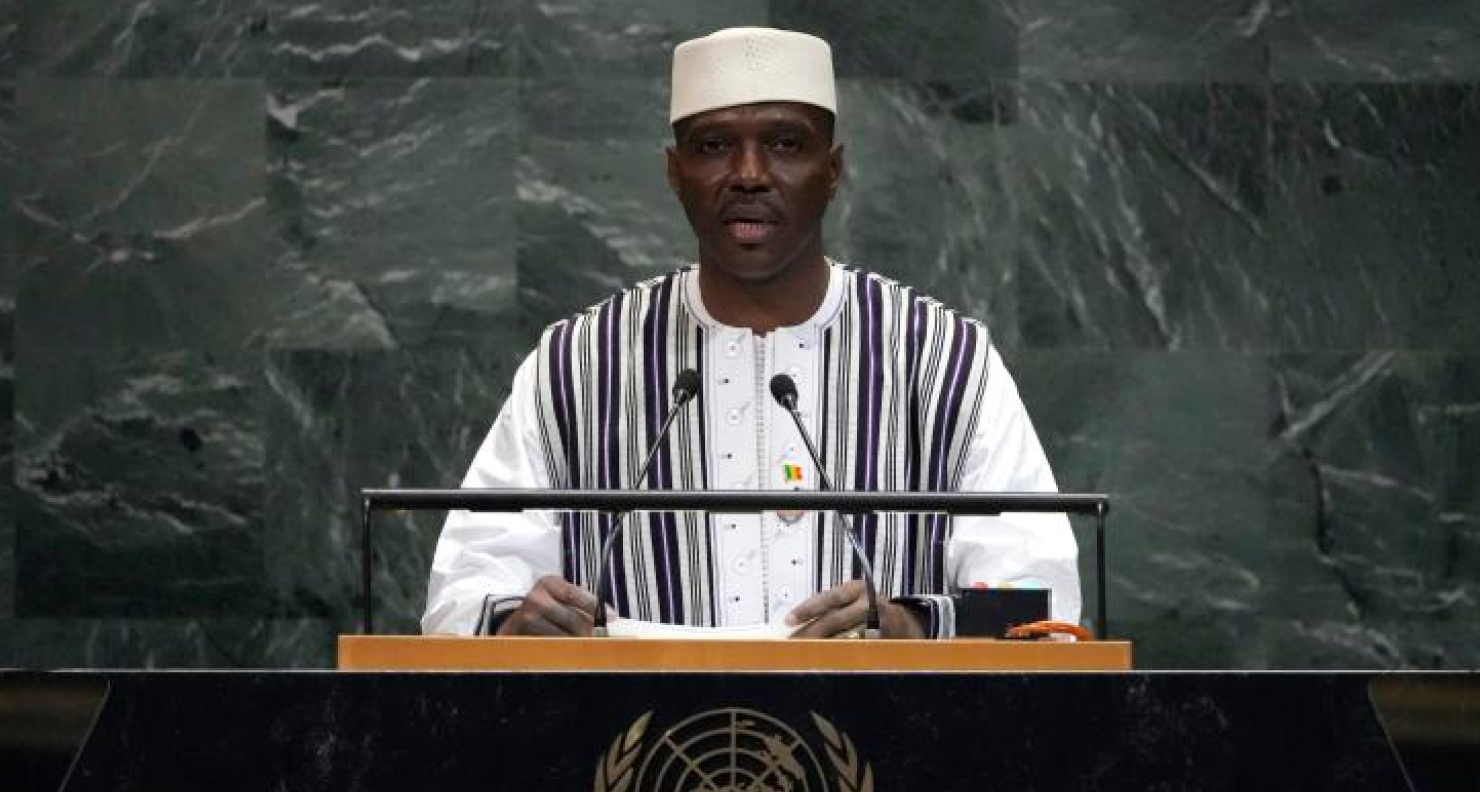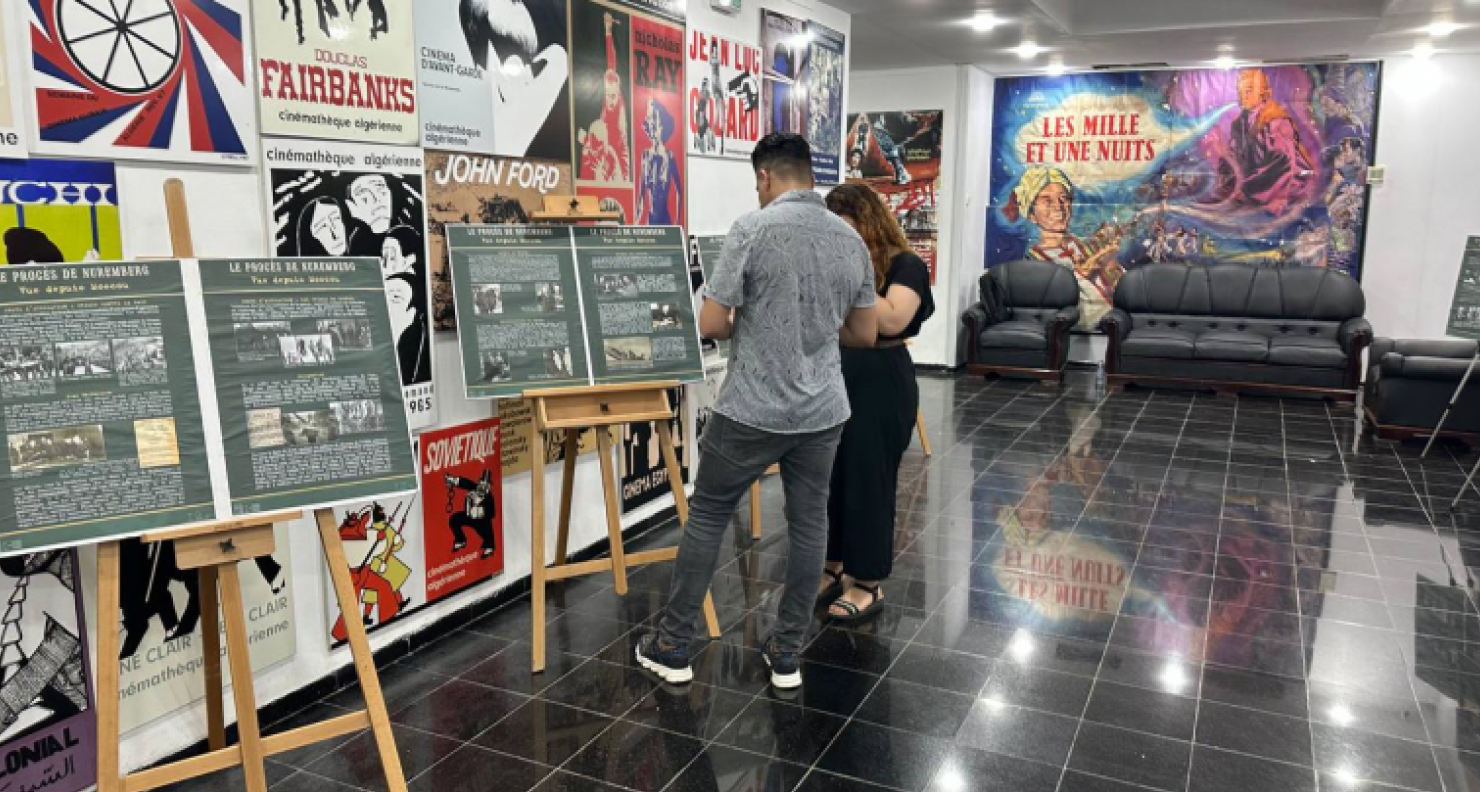En Gambie, cette affaire a rapidement pris une dimension nationale. Trois femmes ont été inculpées pour leur rôle présumé dans l’excision qui a coûté la vie à l’enfant. La tragédie, survenue à proximité de la capitale, a choqué l’opinion publique et exposé la vulnérabilité extrême des nourrissons face à ces rituels. Les chiffres sont alarmants : plus de 75 % des Gambiennes âgées de 15 à 49 ans ont subi une excision, selon les données officielles. Ce taux, l’un des plus élevés au monde, illustre la persistance de cette tradition et la difficulté à la faire reculer, malgré des campagnes de sensibilisation et un cadre légal censé la proscrire.
La militante des droits humains Fatou Diagne Senghor, invitée d’Afrique Midi, a rappelé que la lutte contre les MGF exige un engagement collectif et un renforcement des moyens : « Chaque tragédie doit être un point de bascule vers un changement réel », plaide-t-elle. Pour elle, la société civile et les autorités doivent conjuguer leurs efforts, en misant sur l’éducation communautaire, l’application stricte de la loi et un soutien accru aux victimes. La mort de ce nourrisson rappelle avec brutalité que l’excision n’est pas un vestige du passé mais une réalité dangereuse, encore profondément enracinée en Gambie. Si le chemin vers son éradication reste long, l’émotion nationale suscitée par ce drame pourrait devenir le moteur d’un changement durable, protégeant ainsi les générations futures.