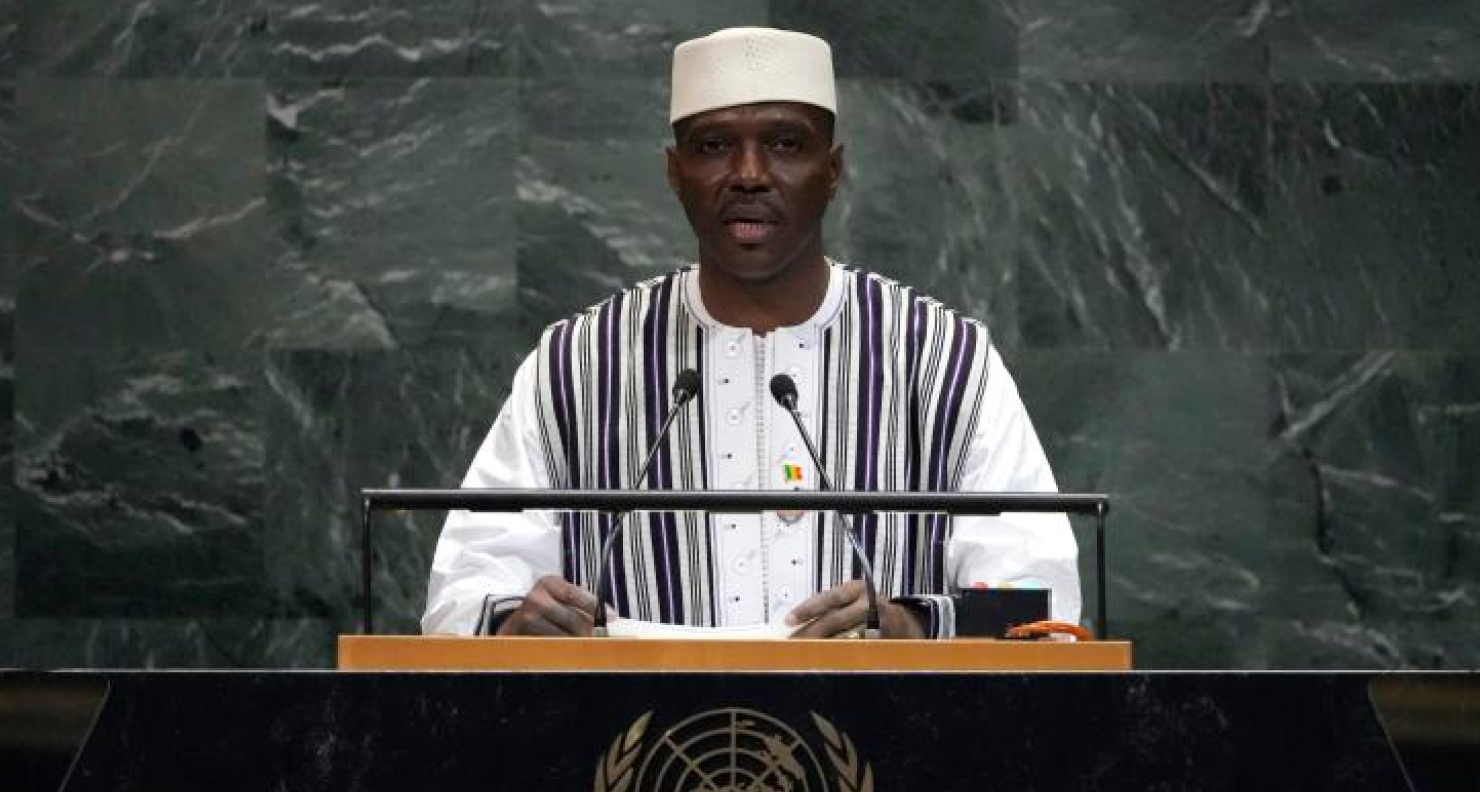Dans une décision présentée comme un tournant stratégique, la Banque Mondiale a annoncé l’introduction d’un quota minimum de 30 % d’emploi local dans les projets qu’elle finance. Cette règle entrera en vigueur le 1er septembre prochain et concernera principalement les secteurs des infrastructures, notamment les transports et l’énergie, domaines clés pour les économies africaines.
L’objectif de cette nouvelle politique est clair : faire en sorte que les projets financés ne se limitent pas à la construction d’infrastructures, mais contribuent aussi directement à la création d’emplois, au transfert de compétences et au développement des économies locales. Pour de nombreux pays africains, cela pourrait représenter une opportunité concrète de lutter contre le chômage, en particulier chez les jeunes, tout en renforçant les capacités techniques locales.
Selon Galina Vincelette, vice-présidente chargée des opérations à la Banque Mondiale, cette mesure vise à « générer davantage d’opportunités locales et à renforcer le lien entre financement international et développement humain durable ». Le président de l’institution, Ajay Banga, a pour sa part fait de la création d’emplois un axe central de sa stratégie de lutte contre la pauvreté.
Pour la jeunesse africaine, confrontée à l’arrivée de plus de 1,2 milliard de nouveaux entrants sur le marché du travail d’ici dix ans, cette réforme pourrait ouvrir des perspectives tangibles. Les projets pourraient devenir des lieux de formation, de montée en compétences et de stabilité économique. En parallèle, les entreprises internationales devront adapter leurs pratiques de recrutement et investir dans la qualification de la main-d’œuvre locale.
Un système de suivi statistique est prévu pour évaluer l’impact réel de cette politique. Les gouvernements africains devront également jouer un rôle actif en veillant à la bonne application de cette règle sur le terrain. En renforçant l’ancrage local de ses projets, la Banque Mondiale envoie un signal fort : les populations africaines doivent être au centre du développement, non plus seulement bénéficiaires, mais aussi actrices de leur propre avenir.