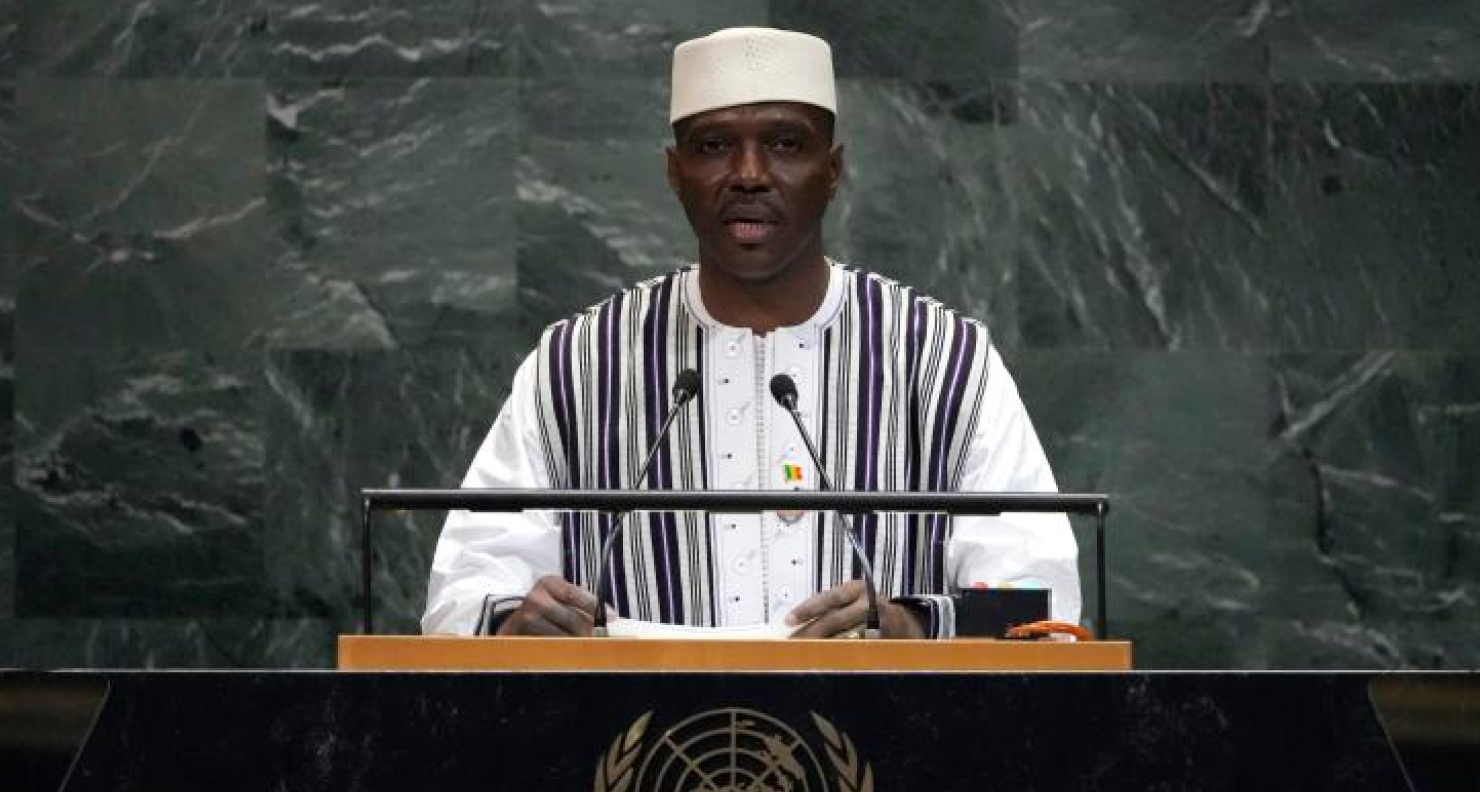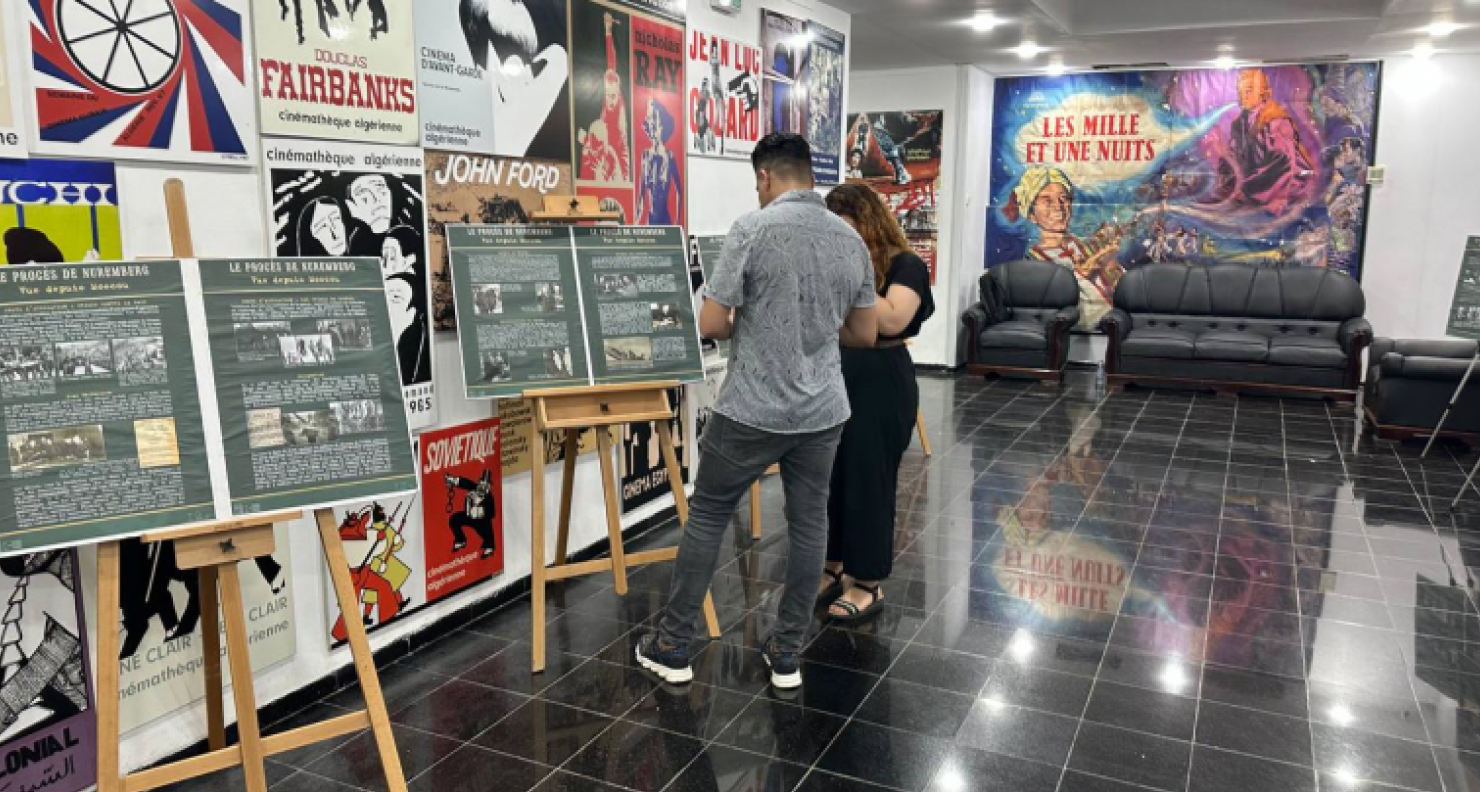Un conflit enraciné dans l’histoire et les déséquilibres internes
Depuis le 15 avril 2023, le Soudan est en proie à un affrontement armé entre les Forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR), une guerre qui a déjà déplacé plus de 14 millions de personnes et plongé l’économie dans une chute libre. Loin d’être un épisode isolé, cette crise est l’héritière de décennies de marginalisation régionale, d’armement de milices et de centralisation des infrastructures autour de Khartoum. La montée en puissance des FSR, issues des périphéries négligées, a abouti à leur contrôle partiel du cœur économique du pays.
L’or, le Nil et la guerre des influences
Le conflit prend également racine dans des enjeux économiques majeurs, notamment autour de l’or dont les FSR contrôlent une large part des exploitations et du Nil, ressource vitale disputée dans le cadre du barrage de la Renaissance. Ces intérêts attirent des puissances régionales (Égypte, Éthiopie) et internationales (Émirats, Russie via Wagner, États-Unis), transformant la guerre en un champ d’influence stratégique. Les luttes internes soudanaises deviennent ainsi le miroir d’affrontements géopolitiques plus larges.
Une crise humanitaire sans précédent et une résistance en quête de cap
Sur le terrain, les conséquences humanitaires sont catastrophiques, avec près de 12 millions de déplacés internes et réfugiés. Dans un contexte d’abandon étatique, les comités de résistance jouent un rôle crucial à travers des structures d’entraide locales, bien qu’ils peinent à proposer une vision politique unifiée face à la désintégration de l’État. Le Soudan, en crise systémique, soulève ainsi la nécessité d’un projet révolutionnaire structuré pour penser au-delà de la survie et reconstruire durablement.