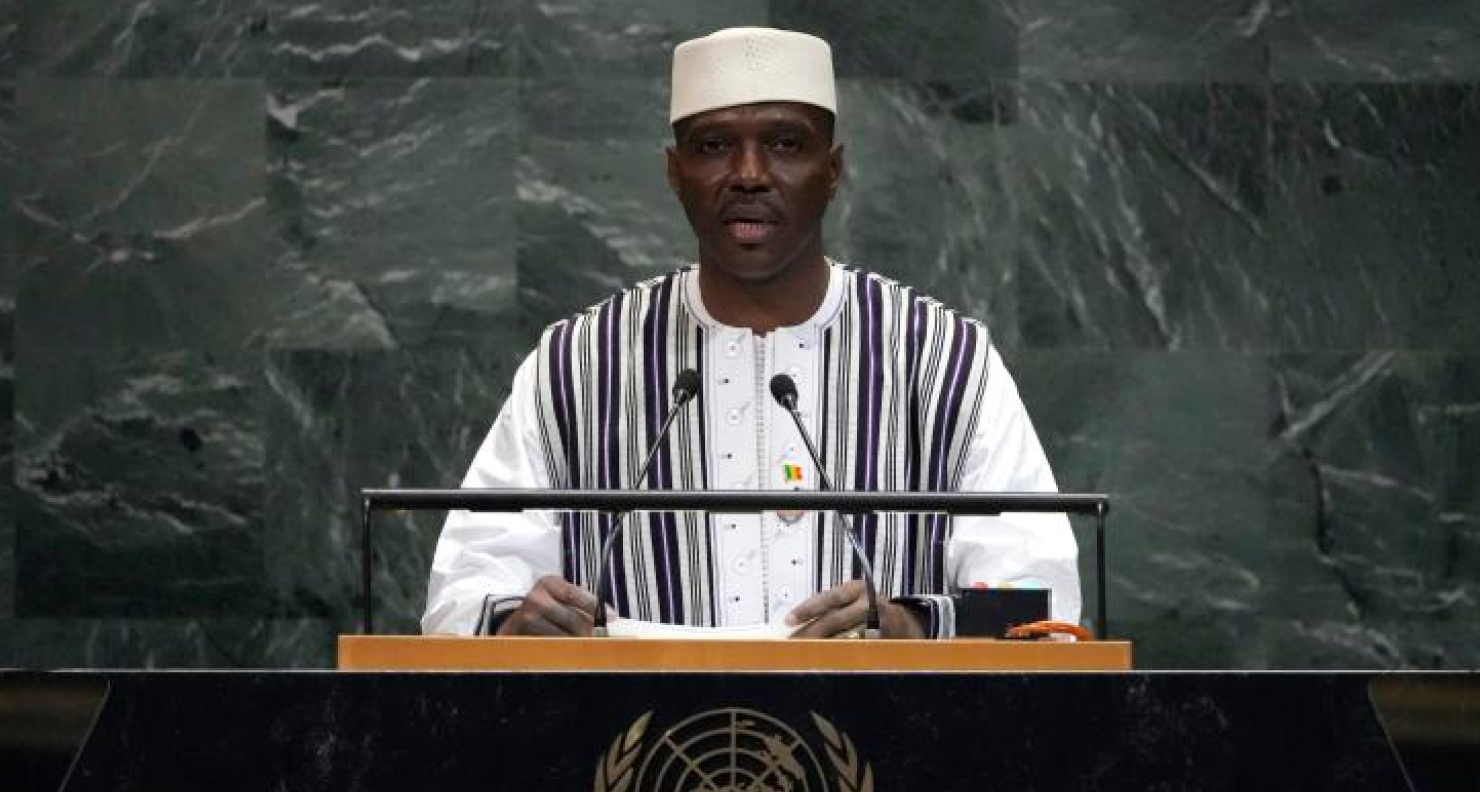Depuis 2015, Kigali a amorcé un processus visant à bannir progressivement les fripes, avec l’objectif d’habiller 100 % de sa population avec des vêtements locaux d’ici 2029. Pour cela, le Rwanda a multiplié par dix la taxe sur le kilo de vêtements usagés dès 2016 et investi massivement dans la formation et la modernisation de ses filières textile et cuir. Le gouvernement compte ainsi créer 250 000 emplois par an dans ce secteur.
Cette politique ferme contraste avec la prudence de certains voisins. Le Kenya a fait marche arrière en 2017 sous la pression des États-Unis, qui menaçaient de revoir les avantages commerciaux accordés par l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), essentiels pour ses exportations vers les États-Unis, évaluées à près de 600 millions de dollars. L’Ouganda et la Tanzanie ont en revanche maintenu leurs restrictions sur les fripes, poursuivant eux aussi le développement de leurs industries textiles locales.
Le Rwanda fait face à plusieurs défis majeurs. Le coût élevé des matières premières et la dépendance aux tissus importés limitent la compétitivité locale. Par ailleurs, une nouvelle concurrence se profile : les importations croissantes de vêtements neufs, bon marché, venus de Chine, qui représentent désormais un marché de 1,2 milliard de dollars en Afrique de l’Est. Ce phénomène complique la capacité des industriels locaux à rivaliser sur les prix et les styles.
La situation du Burundi illustre la complexité de ce virage. Exclu de l’AGOA depuis 2016, il ne redoute pas de sanctions commerciales, mais son industrie textile est faible, dépendante des importations de matières premières, tandis que la production de coton chute. Le commerce des fripes y est très développé et emploie des milliers de personnes, car il répond à un faible pouvoir d’achat.

À l’échelle de la Communauté de l’Afrique de l’Est, la volonté de réduire la dépendance aux fripes est un signe fort d’aspiration à l’autonomie industrielle et économique. Néanmoins, cette démarche s’accompagne de nombreux enjeux, entre protectionnisme, pressions internationales et réalités sociales. Le succès dépendra de la capacité des pays, particulièrement du Rwanda, à construire des industries textiles compétitives, capables de produire localement des vêtements à la fois abordables et désirables. L’expérience rwandaise, résolue et ambitieuse, pourra inspirer l’ensemble de la région, à condition que les défis économiques et sociaux soient gérés avec pragmatisme et persévérance.
Sources : https://allafrica.com/stories/202504010014.html https://rwandadispatch.com/industrial-policy-takes-precedence-over-agoa-says-trade-minister/?utm_source=chatgpt.com