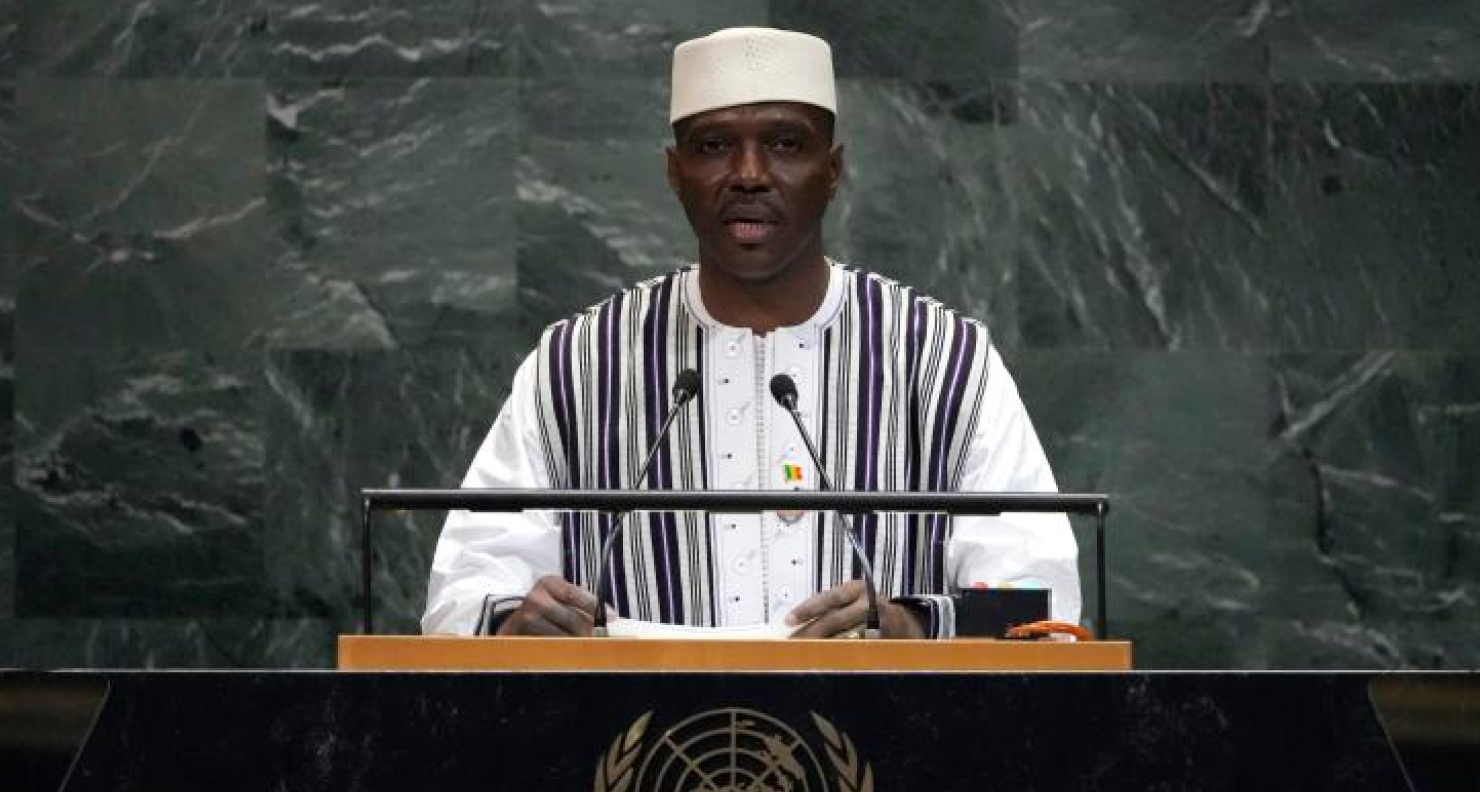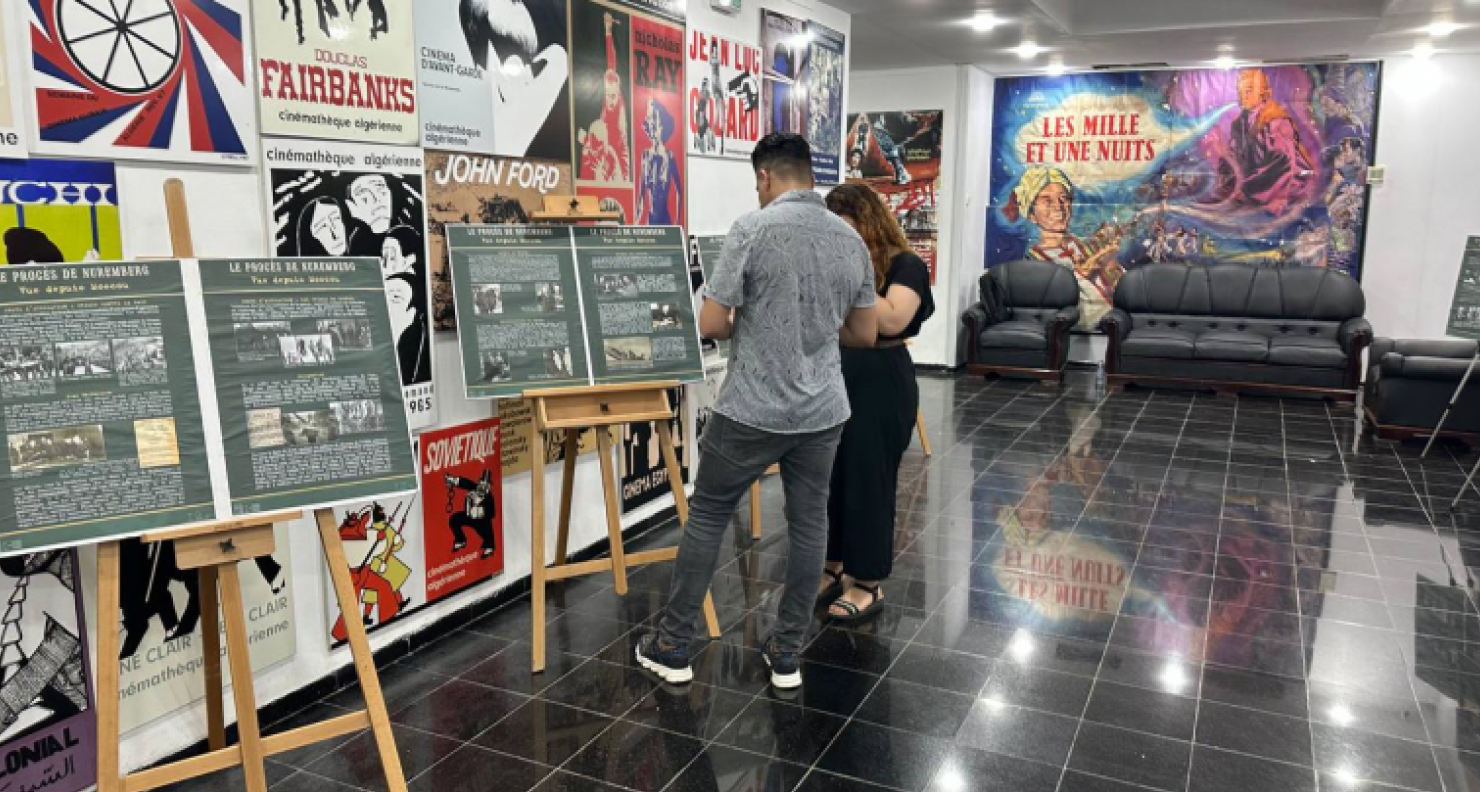Lancé sur les réseaux sociaux, le mouvement vise à dénoncer certaines pratiques dans des salons africains, notamment un accueil perçu comme froid, un service jugé impersonnel et des prix élevés. Les initiatrices, principalement des femmes afro-américaines, estiment ne pas être respectées en tant que clientes. Des hashtags tels que #BoycottAfricanBusinesses et #AfricanHairSalonProblems ont largement circulé, donnant une visibilité nationale à l’appel au boycott prévu à partir du 1er août 2025.
Cette initiative suscite un débat sur l’unité de la diaspora noire. Si le boycott a historiquement été un outil central de la lutte afro-américaine pour les droits civiques, cette nouvelle campagne divise. Les commerçants africains, souvent à la tête de petites structures familiales, expriment leur inquiétude face à un mouvement qu’ils jugent injuste et économiquement menaçant. Le différend révèle des tensions culturelles entre deux histoires noires : celle des Afro-Américains, marquée par l’esclavage et la ségrégation, et celle des Africains immigrés, concentrés sur l’entrepreneuriat et porteurs d’autres codes culturels.
Certains observateurs appellent à relativiser l’ampleur du mouvement, le qualifiant de phénomène médiatique amplifié par TikTok. Face aux critiques, plusieurs voix de la diaspora ont choisi de transformer la date du boycott en une journée de soutien aux entreprises africaines, sous le slogan « Buy Black and African ». Dans un contexte de fragilisation des politiques de diversité, ce débat souligne l’importance d’un dialogue renouvelé entre les composantes de la diaspora noire, pour préserver un tissu économique commun.