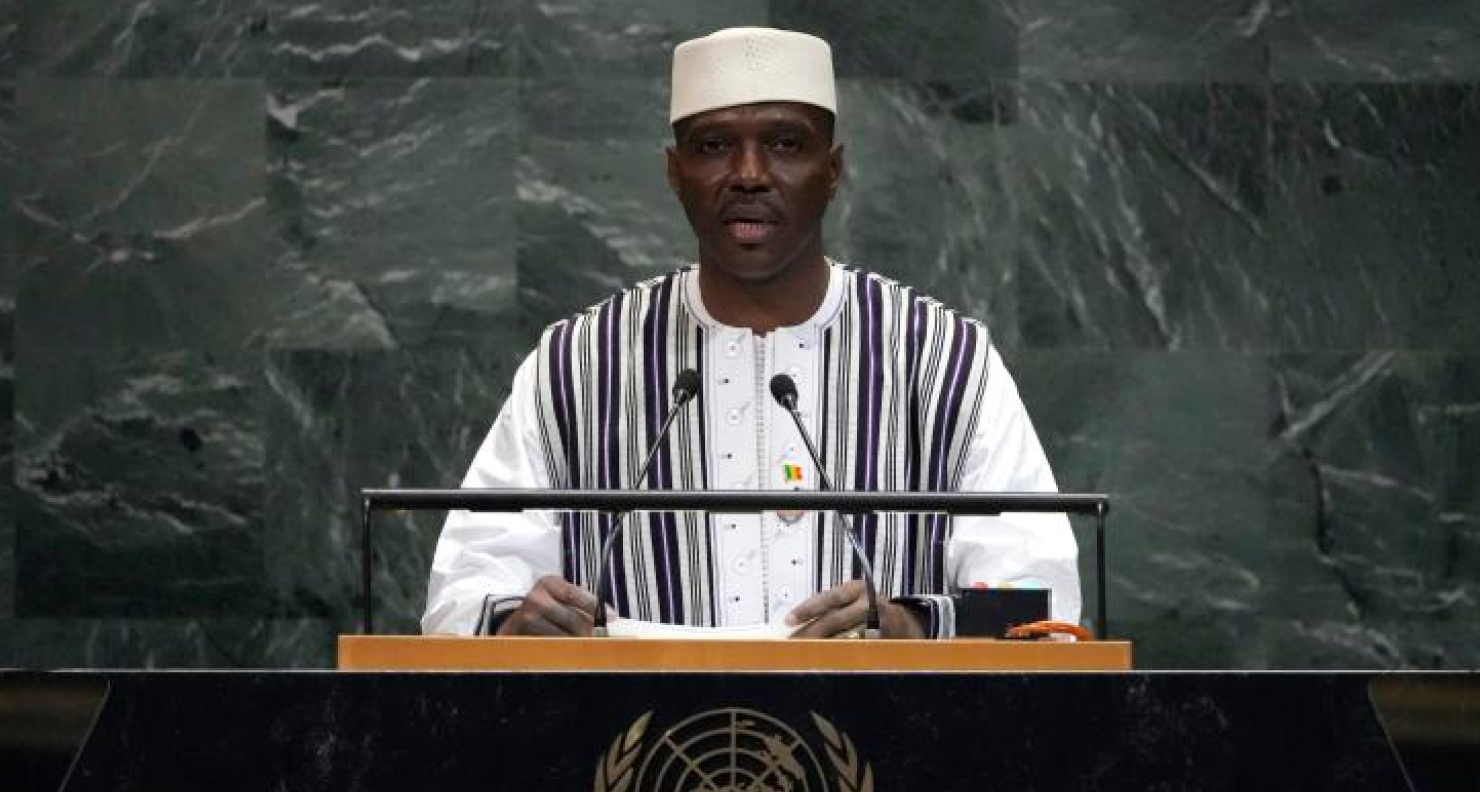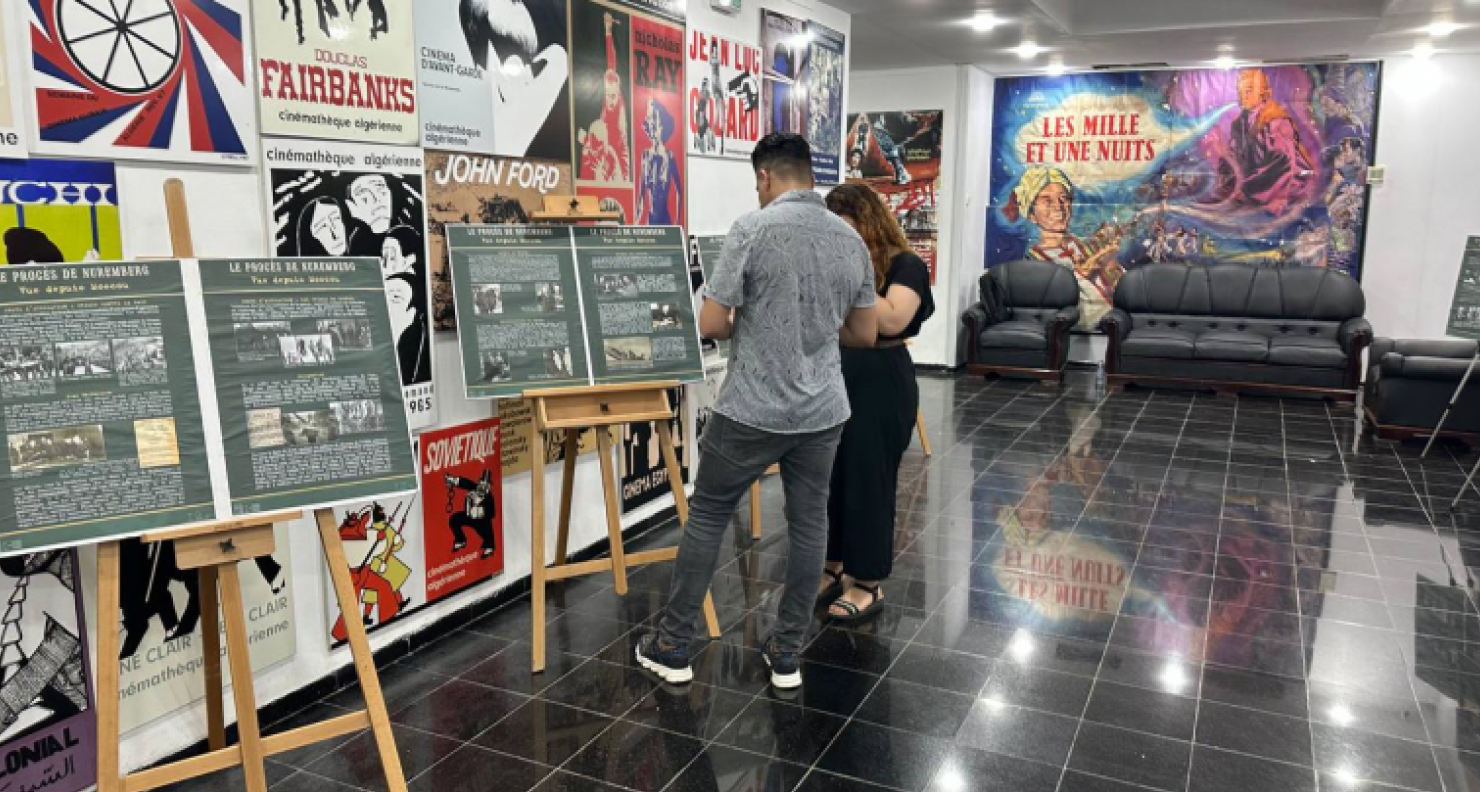Un accord évoqué puis contesté
Depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche en janvier 2025, les États-Unis cherchent à externaliser leurs expulsions en concluant des accords de réinstallation avec des pays tiers. Le Rwanda a confirmé en accueillir jusqu’à 250, tandis que l’Ouganda aurait également été approché. Selon CBS, Kampala aurait accepté d’examiner les dossiers de migrants africains et asiatiques déboutés de l’asile aux États-Unis, sous réserve qu’ils n’aient pas d’antécédents criminels. Le secrétaire permanent du ministère des Affaires étrangères, Vincent Bagiire, aurait même confirmé un accord temporaire avec des conditions strictes.
Mais dès le 20 août, les autorités ougandaises ont fermement démenti. Le ministre d’État aux Affaires étrangères, Okello Oryem, a assuré qu’« aucun accord de ce type n’a été signé », invoquant l’absence d’infrastructures pour accueillir ces personnes. Ces démentis contrastent avec les premières déclarations attribuées à Kampala, renforçant l’incertitude autour du dossier.
Un contexte diplomatique tendu
Cette affaire intervient dans un climat déjà marqué par des tensions entre Kampala et Washington. Les États-Unis ont imposé des sanctions de voyage à plusieurs responsables ougandais et ont retiré le pays du régime commercial de l’AGOA après l’adoption d’une loi anti-LGBTQ+ en 2023. Dans ce contexte, l’éventualité d’un accord migratoire apparaît particulièrement sensible.
Pour les observateurs, le cas ougandais illustre les dilemmes des pays africains confrontés aux pressions américaines. Tandis que le Rwanda a choisi la coopération, Kampala affiche une position ambivalente, oscillant entre ouverture diplomatique et refus catégorique. Cette incertitude souligne les enjeux de souveraineté et les implications humanitaires que posent ces politiques migratoires externalisées.